
IA, jeunes et éducation : comprendre pour mieux accompagner
Par Agathe Franck
| Année de publication | 2025 |
| Format | Article |
| Thème | Lecture, Ecriture, Oralité |
| Mots-clés | Écologie, Informatique, Sujets de société |
Retour sur le Panier du médiateur
Le 30 septembre 2025, Lecture Jeunesse a consacré son Panier du médiateur, un rendez-vous régulier pour les médiateurs et médiatrices, à un sujet devenu incontournable : l’utilisation de l’intelligence artificielle par les jeunes.
En effet, l’IA ne se limite pas à un outil technologique. Elle agit comme un miroir des mutations culturelles, cognitives et sociales qui traversent une génération. Pour les adolescents, elle transforme la manière d’apprendre, de lire, d’écrire et même de se dire. Derrière les chiffres et les usages, c’est tout un rapport à la connaissance, à l’écriture et à soi qui se redessine. Ce webinaire du Panier du médiateur en dresse le portrait, entre éclairages scientifiques, pratiques de terrain et pistes pour une éducation à l’esprit critique.
Une génération déjà familière de l’IA
Agathe Franck – Observatoire de la lecture et de l’écriture des adolescents
L’ouverture du webinaire a permis de dresser un panorama de l’utilisation de l’intelligence artificielle par les jeunes (un article dédié répertorie toutes les données citées et approfondit le sujet).
Entre 2024 et 2025, son usage a explosé :
- 93 % des jeunes de 18 à 25 ans ont utilisé une IA générative dans les six derniers mois,
- et 42 % en font un usage quotidien, soit une progression de 20 points en un an.
Les outils dominants sont ChatGPT et My AI (Snapchat), mais de nouvelles applications apparaissent sans cesse, rendant les usages mouvants et diversifiés.
Cette appropriation massive traduit un glissement : l’IA n’est plus un objet de curiosité, mais un compagnon cognitif du quotidien.
Les usages sont multiples :
- dans la sphère scolaire, l’IA aide à reformuler, résumer, traduire, ou préparer un exposé ;
- dans les loisirs, elle sert à organiser un voyage, créer une image, ou écrire un texte ;
- dans la vie intime, elle devient parfois un interlocuteur émotionnel.
Les jeunes en apprécient la rapidité, la clarté, et surtout le non-jugement.
Mais cet engouement s’accompagne d’une vigilance : près de la moitié des adolescents trouvent l’IA « inquiétante », conscients de ses limites et des risques liés à la vie privée. Interrogés, les jeunes indiquent cependant que cela ne les empêche pas forcément d’utiliser l’IA en dépit de son coût éthique et environnemental.
Cette ambivalence, entre fascination et prudence, devient un marqueur générationnel.
« Qu’on l’aime, qu’on la déteste ou qu’on soit indifférent, elle reconfigure les apprentissages, les émotions et les représentations, particulièrement chez les jeunes qui en sont les premiers explorateurs. »
Donner du sens à la technologie
Samuel Nowakowski – Université de Lorraine, LORIA
Le chercheur Samuel Nowakowski a poursuivi avec une intervention dense et philosophique, rappelant la nécessité de replacer la technologie dans une perspective critique.
Pour illustrer le rapport entre croyance et connaissance, il a convoqué l’« hypothèse du fermier » de Bertrand Russell :
des dindes, nourries chaque jour à 11 h par leur fermier, en déduisent une loi universelle… jusqu’au 24 décembre, où elles sont abattues.
Une métaphore pour souligner la fragilité de nos certitudes face à la technologie : la confiance aveugle dans les régularités apparentes peut conduire à l’erreur.
Comme le rappelle Samuel Nowakowski, « nous baignons dans un monde de données : toutes les informations que nous produisons servent de matière première aux systèmes que nous utilisons ».
L’IA : prolongement ou rupture ?
Samuel Nowakowski rappelle que l’IA n’est pas née avec ChatGPT : elle s’inscrit dans une longue histoire d’externalisation des capacités humaines. Depuis les années 1950, elle s’attache à reproduire quatre facultés cognitives : la perception, le raisonnement, l’apprentissage et le langage.
Mais c’est la vitesse de diffusion des technologies qui interroge : il a fallu à ChatGPT trois jours pour atteindre un million d’utilisateurs, contre plusieurs mois pour Netflix.
Aujourd’hui, nous utilisons essentiellement des IA « faibles » (des systèmes spécialisés, capables de traiter des images, du texte ou des données). Les IA « fortes », douées d’autonomie et de conscience, relèvent encore de la science-fiction.
Entre fascination et responsabilité
Mais il met en garde contre l’usage non réfléchi des IA génératives, en évoquant l’expérience du bouton rouge :
« Si vous appuyez sur ce bouton, vous obtenez un texte original et sans faute, mais en contrepartie, vous participez à une exploitation massive de ressources, à de la pollution, à la suppression d’emplois et à l’utilisation de contenus d’autres personnes. »
En conclusion, il évoque la théorie de l’apprenti sorcier de Goethe, symbole de la démesure technologique :
« Un novice tente de faire une formule magique pour se libérer et pour ne pas faire la tâche que lui a demandé son maître pendant son absence. La situation lui échappe, et c’est seulement au retour du sorcier et grâce à lui que le problème est résolu. »
Il appelle à une vigilance éthique :
- Comprendre que ces outils véhiculent une vision du monde (souvent celle des grandes entreprises américaines).
- Déterminer des limites pour minimiser les conséquences néfastes.
- Favoriser une culture critique et une éducation à l’éthique de l’IA.
Développer l’esprit critique face aux IA
Morgane Guillet – Journaliste scientifique (Brief.science)
Dans la deuxième intervention, la journaliste et médiatrice scientifique Morgane Guillet a partagé son expérience d’ateliers menés dans les lycées normands autour de l’éducation aux médias et à l’information (EMI).
Son approche repose sur un principe clair : on apprend mieux en manipulant.
Atelier 1 : Comprendre la fiabilité de l’IA
Avant l’atelier, les élèves remplissent un questionnaire pour décrire leurs usages de l’IA, leurs attentes et leurs perceptions.
L’activité commence ensuite par une réflexion : quels objets du quotidien utilisent l’IA ?
Cela permet de rappeler que l’intelligence artificielle existait avant ChatGPT (reconnaissance d’image, prédiction, génération).
L’exercice central consiste à utiliser Vittascience, une interface permettant de visualiser le fonctionnement d’une IA : à chaque mot produit, les élèves voient la probabilité du mot suivant.
Ils découvrent que l’IA prédit les mots, sans « comprendre » réellement les phrases. L’outil permet aussi de comprendre l’impact environnemental de chaque requête.
Les élèves comparent aussi les réponses de plusieurs IA à des questions de santé. Ils constatent des divergences, des erreurs et l’absence d’un « je ne sais pas ».
Autre exercice : demander à une IA de réécrire un article journalistique pour comparer la qualité et la fiabilité du texte produit.
L’objectif est de comprendre la valeur ajoutée du journaliste humain, à savoir vérification, hiérarchisation et contextualisation.
Enfin, Morgane Guillet prépare la publication d’un kit pédagogique de six activités en ligne, incluant :
- l’analyse d’images historiques manipulées par IA ;
- des exercices de vérification de fausses informations ;
- ou encore le jeu FAIT ou FAKE, où les élèves doivent justifier leurs réponses face à l’IA.
Atelier 2 : Décoder le fonctionnement des IA
Grâce à des outils comme Vittascience ou Quickdraw (Google), les jeunes observent concrètement comment une IA apprend à reconnaître ou générer des images.
Ces dispositifs permettent de visualiser les biais, mais aussi la logique mathématique sous-jacente : un apprentissage par répétition, sans compréhension réelle.
Les ateliers débouchent sur des discussions autour de :
- la consommation énergétique des IA ;
- les travailleurs invisibles chargés d’entraîner les modèles ;
- les enjeux sociaux et écologiques du numérique.
L’IA à l’école : entre prudence et expérimentation
Florian Reynaud – Professeur documentaliste, collège du Renon (académie de Lyon), APDEN
Le troisième intervenant, Florian Reynaud, a présenté un retour d’expérience de terrain.
En collège rural, il intègre progressivement l’IA dans l’enseignement de l’EMI et des sciences de l’information et de la communication.
Pour lui, l’IA n’est pas seulement un outil : c’est un objet d’étude et d’enseignement. L’APDEN a aussi commencé une réflexion collective avec le wikinotion.apden.org avec des propositions de ressources.
Une progression par niveaux
Son approche est progressive :
- En 6e, introduction ponctuelle à l’IA à travers l’actualité et la recherche d’informations.
- En 5e, séquence complète (4 heures) sur le fonctionnement d’internet, les IA génératives et leurs effets environnementaux et sociaux. Les élèves comparent plusieurs IA sur un sujet local et analysent les informations erronées.
- En 4e, travail sur les droits à l’image et à l’information, comparant moteurs de recherche et IA.
- En 3e, usage encadré de l’IA comme outil d’aide pour la préparation de l’oral du brevet.
Ces activités amènent les élèves à questionner les sources, à comprendre les erreurs produites par les IA et à prendre conscience des enjeux liés à la création automatisée.
Il aborde également les stéréotypes générés par les IA d’images, pour montrer d’où viennent ces représentations biaisées.
Observer pour comprendre
Florian Reynaud insiste sur l’importance de l’observation active : les élèves comparent les résultats de plusieurs IA sur un sujet local (par exemple leur propre village) et constatent les erreurs ou incohérences.
Ces “hallucinations” (qui n’est pas un terme utilisé avec les élèves) deviennent des points d’entrée pour interroger la fiabilité des sources et la notion de vérité.
Son objectif n’est pas de moraliser, mais d’éveiller la curiosité critique.
Florian Reynaud insiste enfin sur la nécessité de former les enseignants : si le ministère a publié une charte sur l’usage de l’IA en 2025, son application reste encore floue sur le terrain.
Trois messages clés pour les médiateurs
En clôture du webinaire, les trois intervenants ont livré des messages de synthèse :
- Samuel Nowakowski : « Comprendre pour mieux critiquer et mieux utiliser. »
- Morgane Guillet : « Les IA génèrent des choses impressionnantes, mais il faut garder le recul critique et comprendre leurs limites. »
- Florian Reynaud : « Ne pas avoir peur de l’IA et accompagner les élèves sans vision négative. »
Ces paroles font écho à la philosophie de Lecture Jeunesse : éduquer à la lucidité plutôt qu’à la méfiance, donner les outils pour comprendre avant de juger.
En conclusion : accompagner l’utilisation de l’intelligence artificielle par les jeunes
Ce Panier du médiateur a montré combien l’intelligence artificielle est aujourd’hui au cœur des pratiques culturelles et éducatives des jeunes.
Elle transforme leur rapport à la connaissance, à la lecture et à l’écriture, mais aussi leur rapport à eux-mêmes.
Pour l’Observatoire de la lecture et de l’écriture des adolescents, il s’agit d’un chantier essentiel : accompagner les médiateurs et médiatrices qui œuvrent auprès des jeunes dans la compréhension de ces outils, et inventer de nouvelles médiations de l’écrit à l’ère de l’IA.
Pour aller plus loin
Afin d’être informés des prochains rendez-vous, abonnez-vous à la newsletter de Lecture Jeunesse. Pour les dernières actualités et ressources concernant les pratiques culturelles des jeunes, vous pouvez aussi vous abonner à la nouvelle newsletter de l’Observatoire.
Pour aller plus loin dans vos pratiques de médiation, consultez le programme des formations en ligne et sur site.
Vous pouvez aussi vous abonner à la revue Lecture Jeune. Le dernier numéro était consacré à la création à l’ère de l’IA.
À propos des webinaires « Panier du médiateur » de Lecture Jeunesse :
Le « Panier du médiateur » est le rendez-vous incontournable expérimenté par l’association Lecture Jeunesse depuis 2021. Ce format en ligne gratuit propose aux médiateurs des clés de compréhension, des exemples de médiations et des pistes de réflexions sur les pratiques culturelles des adolescents. Il est toujours réservé aux questions et aux interrogations des professionnels participant afin de favoriser leurs échanges avec les intervenants, qu’ils soient chercheurs ou professionnels de la médiation.
AUTRES CONTENUS SUR CE THÈME

La création littéraire au défi de l'IA N° 195, septembre 2025
Née de nos rêves de communiquer avec d’autres espèces, l’intelligence artificielle (IA) questionne autant notre…
Voir le produit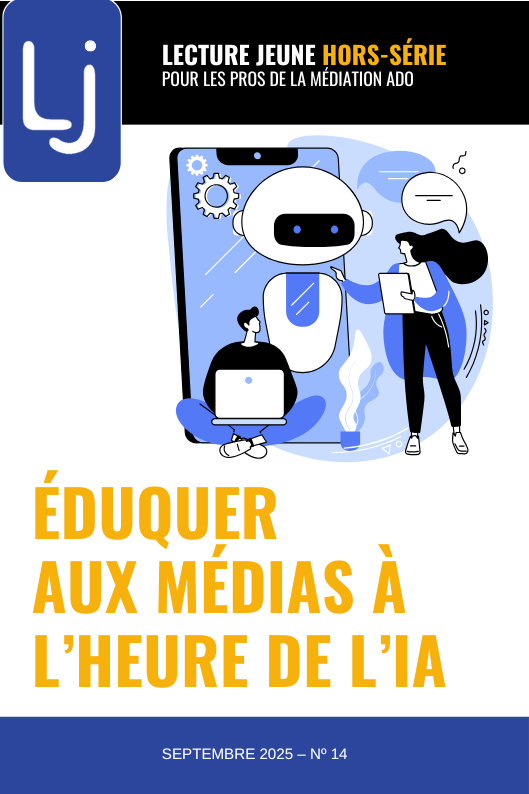
Éduquer aux médias à l'heure de l'IA, Hors-série N° 14, septembre 2025
L’intelligence artificielle vient bouleverser les pratiques de médiation et notamment dans le domaine de l'éducation…
Voir le produit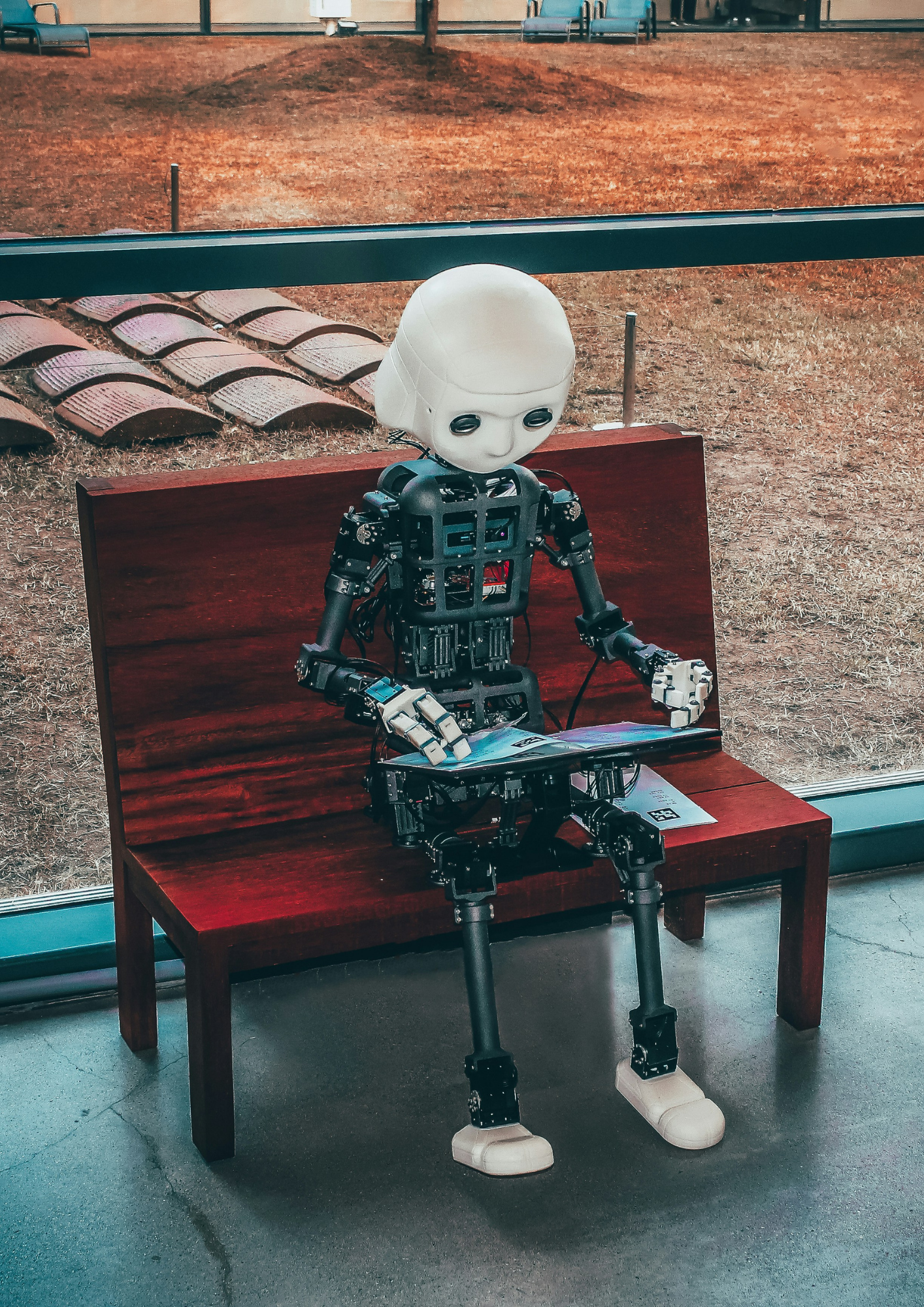
Formation sur site : Découvrir les intelligences artificielles (IA) et leurs enjeux aujourd'hui, en mobilisant les collections ados/jeunes adultes
Résumé. Questionnées depuis des décennies dans les littératures ados, les intelligences artificielles font aujourd’hui partie intégrante…
Voir le produitPOUR ALLER PLUS LOIN
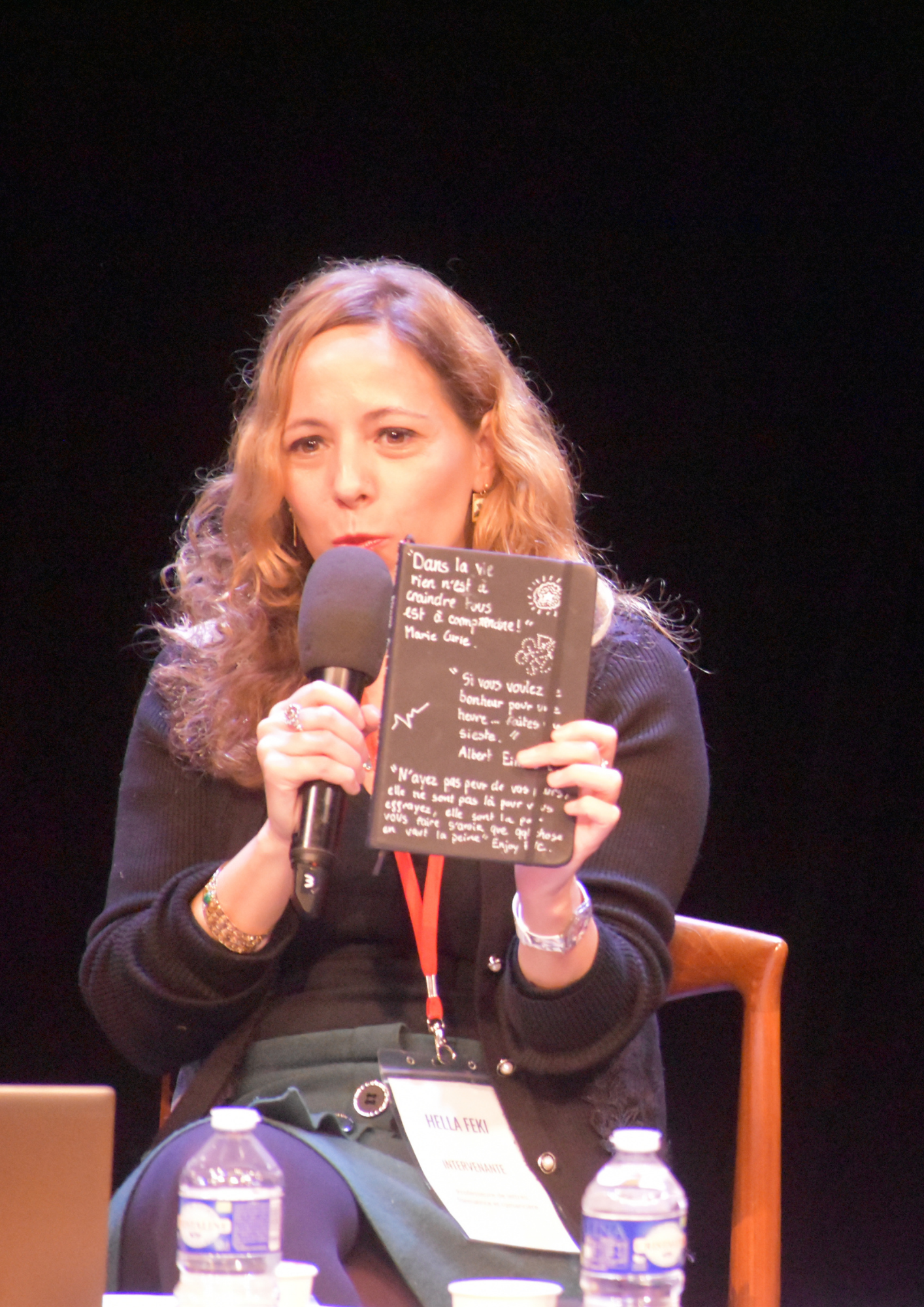
7e édition du colloque annuel de l’Observatoire de la lecture et de l’écriture des adolescents - Les adolescents et leurs pratiques de l'écriture au XXIème siècle : nouveaux pouvoirs de l'écriture ?
Par Observatoire de la lecture et de l'écriture des adolescents
Mardi 12 décembre 2023 à la Maison de la Poésie. Tandis que l’écriture, sa pratique et son apprentissage réinvestissent aujourd’hui l’espace public[mfn]Tribune collective, « M. Gabriel…
Lire l'article
Amener les adolescents à la lecture : la mission de Lecture Jeunesse
Par Camille Vincent
Intelligence artificielle et lecture des adolescents : une priorité renforcée. L’année 2024 marque une étape majeure pour Lecture Jeunesse, association qui célèbre son cinquantenaire en…
Lire l'article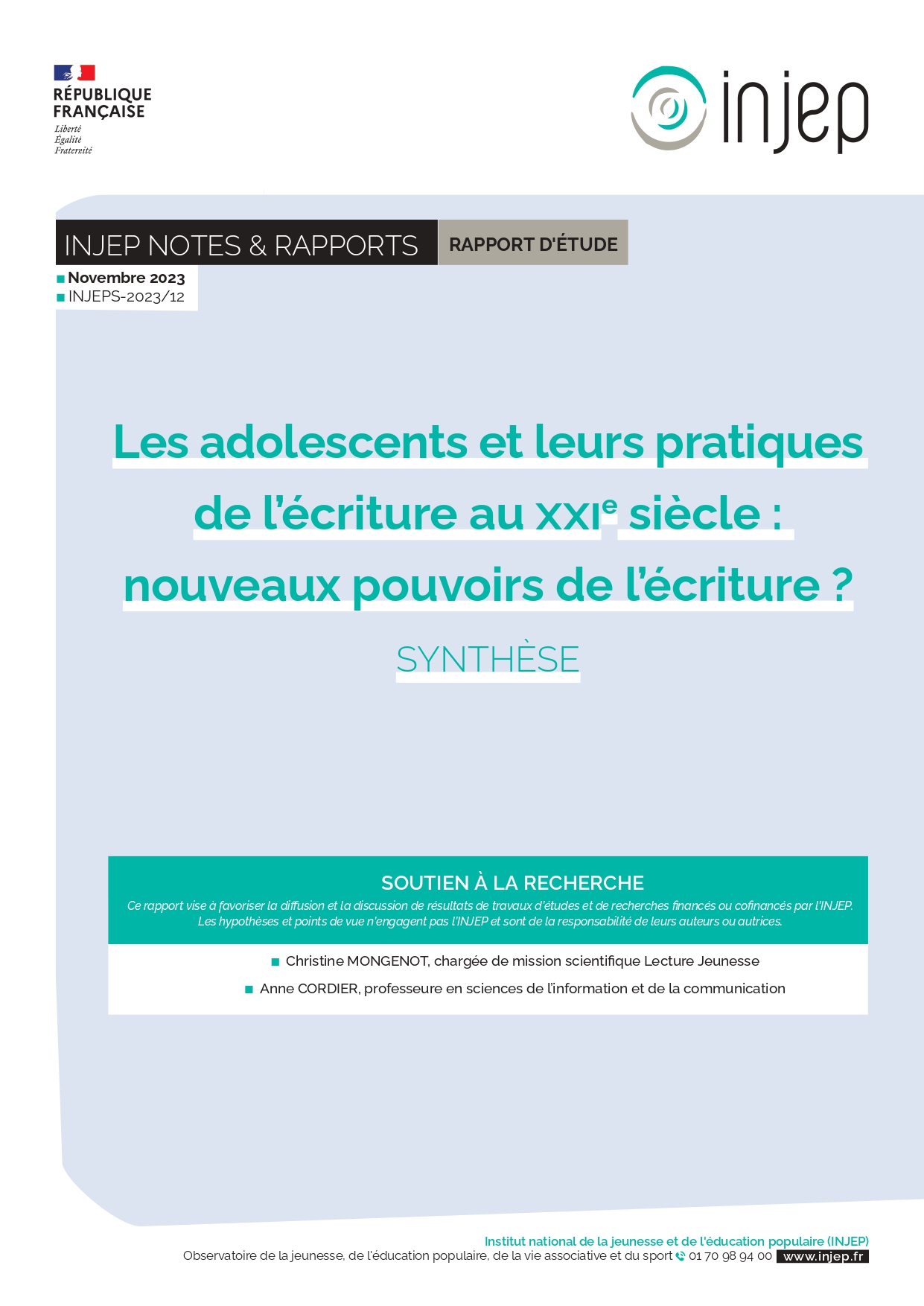
Les adolescents et leurs pratiques de l’écriture au XXIe siècle : quels pouvoirs de l’écriture ?
Par Christine Mongenot , Anne Cordier
Pourquoi l’enquête ? A une époque où l’on peut passer de victime à icone en…
Lire le rapport