
Les jeunes et l’intelligence artificielle : entre fascination, vigilance et nouveaux usages
Par Agathe Franck
| Année de publication | 2025 |
| Format | Article |
| Thème | Lecture, Ecriture, Oralité |
| Mots-clés | Environnement, Informatique, Sciences |
L’intelligence artificielle (IA) n’est plus seulement un mot à la mode : pour les jeunes, elle s’impose déjà comme un outil du quotidien. En ce sens, en l’espace de deux ans, les usages se sont massivement diffusés, bouleversant la scolarité, les loisirs, les relations sociales et même l’intimité des adolescents et jeunes adultes. Cependant, cet engouement s’accompagne de questions inédites : quel impact sur l’éducation ? Sur la santé mentale ? Sur les inégalités ? Ainsi, cette synthèse cherche à centraliser la plupart des rapports et études qui clarifient, à ce jour, comment les jeunes utilisent l’intelligence artificielle générative.
Une génération massivement connectée à l’IA
L’essor est spectaculaire. En 2024, un sondage réalisé auprès de lycéens en Nouvelle-Aquitaine montrait déjà que plus de 90 % des élèves de seconde avaient utilisé une IA générative (IAG) pour faire leurs devoirs (1) (2). Un an plus tard, l’usage est devenu presque universel. En France, selon le baromètre Born AI (une enquête réalisée chez près de 500 jeunes de 18 à 25 ans), entre 85 % (en 2024) et 93 % (en 2025) des jeunes ont utilisé un outil d’IA générative dans les six mois précédant l’enquête (3) (4).
Surtout, l’usage quotidien explose : 42 % des jeunes déclarent en 2025 utiliser l’IA tous les jours, soit deux fois plus qu’en 2024 (4). En parallèle, les données des Cahiers Pédagogiques indiquent qu’un tiers des lycéens et un quart des collégiens l’utilisent plusieurs fois par semaine, voire chaque jour (5). Autrement dit, la génération montante ne se contente plus d’expérimenter : elle intègre ces outils à son quotidien. ChatGPT reste l’outil le plus utilisé à ce jour (4).
Par ailleurs, les différences de genre s’atténuent : filles et garçons sont désormais aussi nombreux à avoir testé l’IA (93 % vs 94 %). Cependant, les garçons en revendiquent un usage quotidien plus fréquent (42 % contre 17 %) (4). Les écarts étaient plus marqués avant la démocratisation de l’IAG (5).
En résumé, pour les adolescents, l’IA est un outil pratique et efficace. Les principales motivations citées sont la rapidité, la clarté et la possibilité de poser des questions. Les jeunes apprécient aussi les interactions sans jugements avec l’IA (6).
De l’aide aux devoirs aux conseils sentimentaux
Les usages scolaires dominent encore largement. L’aide aux devoirs reste le premier usage, avec des taux selon les sources allant de 43 % (7) à 90 % (1) (2). Ainsi, les jeunes y voient un soutien précieux pour la révision, la traduction ou la synthèse de contenus. Mais très vite, l’IA dépasse le cadre académique.
En 2025, plus de 90 % des jeunes déclarent recourir à l’IA pour la recherche d’informations (+8 points par rapport à 2024), et près de deux tiers pour des recommandations personnalisées dans les loisirs, les voyages ou les sorties (4). De plus, l’usage conversationnel progresse lui aussi : 45 % affirment discuter avec une IA « juste pour le plaisir », et 30 % des 13-17 ans apprécient de poser des questions « qu’ils n’oseraient pas poser à un adulte » (7).
Enfin, les IA deviennent aussi des conseillers intimes : entre 20 et 34 % des jeunes déclarent avoir demandé des conseils sentimentaux à un chatbot1Logiciel qui simule le dialogue en langage naturel avec l’utilisateur. (4). L’IA se glisse ainsi dans les zones les plus sensibles de la vie adolescente.
Une école en quête de repères
Face à cette déferlante, l’institution scolaire avance encore à petits pas. En France, seuls 24 % des élèves déclarent avoir accès à l’IA en classe, contre 44 % en Italie et 36 % en Allemagne (8).
À ce stade, le recours des enseignants à l’IA résulte encore largement d’initiatives individuelles et d’expérimentations locales. En outre, le manque de formation reste important : plus de 70 % des enseignants déclarent un niveau moyen à faible en IA et 90 % estiment ne pas avoir reçu de formation adéquate (9). Pourtant, beaucoup en perçoivent l’intérêt : réduire leur charge administrative ou personnaliser l’enseignement (9). Plus de la moitié des professeurs (56 %) aimeraient être formés pour apprendre aux élèves à comprendre et à utiliser l’IA en toute sécurité (8).
Le cadre de l’école en formation
Cependant, ces aspects sont en forte mouvance au sein de l’Éducation nationale. En 2024, le ministère de l’Éducation nationale a lancé « MIA Seconde », une plateforme d’apprentissage adaptatif (10). Mais à la différence des IA génératives comme ChatGPT, MIA repose sur des technologies plus anciennes, ajustant les exercices selon le niveau et le rythme des élèves.
En 2025, un cadre d’usage de l’IA en éducation a été publié (11), mais son appropriation reste incertaine. A partir des résultats de leur enquête, les Cahiers Pédagogiques identifient trois défis pour l’école et les éducateurs : s’approprier l’IA pour mieux l’enseigner, aller plus loin dans son utilisation pédagogique, et former les élèves à l’esprit critique (5).
En Juin 2025, la CNIL a publié une FAQ s’adressant aux enseignants qui souhaiteraient utiliser des systèmes d’IA dans un cadre pédagogique. Elle a vocation à apporter de premières réponses pour une mise en œuvre opérationnelle de ces systèmes en conformité avec le droit à la protection des données et dans le respect des droits et libertés des élèves et des enseignants (12).
Entre fascination et inquiétude
Des jeunes entre curiosité et méfiance
Les jeunes oscillent entre enthousiasme et vigilance. D’un côté, 70 % affirment avoir une opinion globalement positive de l’IA (8). De l’autre, beaucoup expriment des craintes.
Une petite moitié des élèves trouve que l’IA est amusante. À l’inverse, 45 % des collégiens et 60 % des lycéens estiment que l’IA est « quelque chose d’inquiétant ». Les verbatims permettent d’identifier des craintes de deux ordres : les enjeux environnementaux et les effets pour les artistes, en particulier les musiciens ; la peur d’une dépendance à l’IA (5)
Chez les étudiants plus âgés (en études supérieures), 80 % citent la question des données personnelles comme un risque majeur, 59 % s’inquiètent de la fiabilité des réponses, et près de la moitié de l’impact social et démocratique (13). L’environnement n’est pas oublié : 87 % reconnaissent l’impact énergétique de l’IA, même si 63 % pensent qu’elle pourrait aussi être un outil pour lutter contre le réchauffement climatique (13).
Les adolescents se montrent également attentifs aux risques de manipulation : 73 % redoutent la désinformation, 71 % les atteintes à la vie privée et beaucoup s’interrogent face aux deepfakes2Terme mélangeant « Deep Learning » et « Fake », qui désigne un enregistrement vidéo ou audio réalisé ou modifié grâce à l’intelligence artificielle. En fait, il fait référence à des contenus faux qui sont rendus crédibles par l’effet de l’intelligence artificielle. (7).
Les parents et l’école
Leurs parents se disent surtout préoccupés par la collecte de données et l’exposition à des contenus inappropriés (14) (8). Mais un décalage important subsiste : seuls 37 % des parents dont l’enfant utilise l’IA en ont réellement conscience. Près de la moitié des parents ne savent pas à quoi leur enfant est exposé en ligné (15). L’absence de fonctionnalités de contrôle parental sur les plateformes d’IAG contraint les parents à recourir aux dispositifs intégrés par défaut, à vérifier manuellement les historiques, à partager les comptes ou à adopter une médiation active. Malgré ces efforts, ils peinent à saisir pleinement l’étendue des risques liés à l’IAG et à assurer une surveillance, une médiation et une éducation efficaces en temps réel (14).
Chez les enseignants en France, les préoccupations éthiques sont présentes et identifiées mais ne sont pas perçues comme une source de blocage. La confidentialité des données est une préoccupation majeure pour une majorité des répondants à une enquête de l’Inspection générale (9).
L’IA, nouvel interlocuteur émotionnel
L’expansion des chatbots
Un phénomène plus discret mais lourd de conséquences émerge, d’autant plus qu’il est encore très mal compris : l’IA comme « compagnon ». Aux États-Unis, en 2025, une enquête sur 1060 adolescents de 13 à 17 ans a indiqué que 72 % des adolescents affirmaient avoir déjà utilisé un « AI companion ». C’est une intelligence artificielle capable de développer une relation unique avec une personne spécifique (6). Ces IA sont personnalisées en fonction des interactions avec les usagers et/ou un entraînement spécifique. Il existe aussi maintenant des plateformes dédiées à la création de compagnons IA. En France, près d’un jeune sur cinq avait testé des outils comme Character.AI ou MyAI dès 2024 (16).
Cette même étude américaine indique que 33 % des adolescents utilisent une IA compagnon pour des interactions sociales et des relations (9 % en tant qu’ami ou meilleur ami, 8 % pour interactions romantiques) (6). Les motivations sont variées : discuter avec un personnage fictif, bénéficier d’un soutien émotionnel ou se confier sur des sujets intimes. Les jeunes décrivent des échanges marqués par la patience, la bienveillance et l’absence de jugement (1).
S’ils restent attachés aux relations humaines (67 % des jeunes indiquent que les conversations avec l’IA sont moins satisfaisantes que les conversations avec des humains et une très grande majorité priorisent leurs amitiés « humaines » (6)), beaucoup reconnaissent apprécier la disponibilité constante de l’IA. 35 % estiment qu’elle peut aider à lutter contre la solitude, et 41 % y voient un remède à l’ennui. Mais les limites apparaissent vite : seuls 16 % pensent qu’un chatbot peut aider après une rupture amoureuse, et 17 % en cas de dépression ou de burn-out (16).
Lien avec la santé mentale
Les scientifiques alertent : les conversations avec des IA peuvent être satisfaisantes, mais elles ne remplacent pas la profondeur du lien humain et peuvent générer un sentiment de dépendance (6) (17).
Au-delà des chatbots, l’IA est omniprésente dans les réseaux sociaux utilisés par les adolescents. Car selon le baromètre Born AI, My AI (l’outil d’IA de Snapchat) est utilisé par plus de 43 % des jeunes de 18 à 25 ans, en faisant le deuxième outil le plus utilisé derrière ChatGPT (4). Les algorithmes personnalisent le contenu, créent des bulles informationnelles et influencent l’estime de soi (18) (19).
Les effets sont ambivalents. Certains adolescents trouvent dans ces outils un soutien social et un divertissement bienvenu (17). D’autres en subissent les revers : anxiété, dépression, sentiment de comparaison constante (18) (20). Les scientifiques insistent : l’IA renforce souvent les biais déjà existants et accentue les vulnérabilités psychologiques (20). Une analyse de 1 131 utilisateurs et 413 k messages a montré que l’usage « compagnon » de l’IA est associé à un bien-être plus faible quand il est intensif et ne se substitue pas pleinement aux liens humains (21).
Des anecdotes sont de plus en plus relayées par les médias, comme un adolescent dépressif de 16 ans qui s’est donné la mort après avoir suivi les conseils de ChatGPT (22). Cependant, l’IA est aussi envisagée comme piste thérapeutique, notamment pour les jeunes souffrant d’anxiété sociale par exemple (23).
Des experts en santé publique recommandent d’intégrer des modules d’éducation à l’esprit critique numérique dès le collège, afin de permettre aux jeunes de mieux identifier les biais algorithmiques et de préserver leur santé mentale (24).
Des inégalités qui se creusent
Si l’IA se diffuse rapidement, son usage n’est pas égalitaire. Les fractures sociales et territoriales se reflètent dans les pratiques.
50 % des femmes de 16 à 25 ans ont un usage peu régulier de l’IA (moins d’une fois par mois), contre 40 % des hommes. Les jeunes femmes utilisent moins l’IA au quotidien (16 % contre 26 % des garçons) et privilégient davantage des usages scolaires réfléchis. À l’inverse, les garçons l’emploient plus souvent pour le jeu ou la rédaction de devoirs (25).
La fracture territoriale est nette : en France, l’Île-de-France concentre 59 % des utilisateurs, contre seulement 34 % dans les communes rurales, d’après le baromètre 2025 de l’IFOP pour Talan (26).
Enfin, l’origine sociale joue : d’après une enquête CSA pour Milan Presse, les enfants de CSP+ se montrent plus avertis sur les risques de désinformation, et mieux armés pour distinguer un deepfake (7).
À l’international, des inégalités apparaissent aussi : par exemple aux États-Unis, les adolescents afro-américains ont deux fois plus de risques d’être accusés à tort d’avoir utilisé l’IA pour leurs devoirs (15).
L’IA et la reproduction des stéréotypes
Au-delà des inégalités d’accès, l’IA générative soulève un enjeu crucial : celui des stéréotypes. Les modèles ne sont pas neutres : ils reproduisent, et parfois amplifient, les biais sociaux déjà présents dans leurs données d’entraînement.
Des analyses de modèles de génération d’images (T2I) ont révélé que les femmes étaient souvent surreprésentées dans des rôles de soins ou domestiques, tandis que les hommes apparaissaient majoritairement dans des professions techniques ou physiques (27). Par ailleurs, les outils comme DALL·E 2 ou DALL·E 3 ont tendance à sexualiser les femmes ou à les limiter à des métiers stéréotypés, même si leurs versions récentes montrent quelques améliorations marginales (28). De plus, dans des expériences menées en Australie, les générateurs produisaient encore moins de femmes que dans la réalité et n’affichaient pratiquement aucune diversité ethnique (29).
En somme, qu’il s’agisse d’images ou de textes, les IA génératives reflètent les représentations sociales existantes et tendent parfois à les accentuer. Ainsi, pour les jeunes, cela signifie que les conseils scolaires, professionnels ou personnels donnés par ces outils risquent de renforcer des assignations de genre, d’invisibiliser certaines minorités ou d’orienter leurs choix selon des biais implicites.
C’est pourquoi, former les adolescents à repérer et interroger ces biais constitue désormais une compétence essentielle, au même titre que l’éducation aux médias et à l’information.
Une version de cette synthèse figure dans le hors-série de Lecture Jeune de septembre 2025.
Sources
Partie 1
1. Sénat. IA et éducation. octobre 2024. Rapport d’information.
2. Oudeyer, Pierre-Yves. IA générative, société et éducation : En quoi l’IA générative représente-t-elle un enjeu dans la formation des citoyens ? septembre 2024.
3. Agence Heaven. Premiers usages de l’IA chez les jeunes. Baromètre « Born AI ». juin 2024.
4. Agence Heaven. Baromètre Born AI. juin 2025.
5. CRAP-Cahiers pédagogiques. Les élèves face à l’IA : entre séduction et inquiétudes. décembre 2024. Enquête.
6. Common Sense Media. Talk, Trust, and Trade-Offs: How and Why Teens Use AI Companions. juillet 2025.
7. CSA pour Milan Presse. Ados, IA & Deepfakes. mai 2024.
8. GoStudent. L’étude GoStudent sur l’éducation du futur 2025. mai 2024.
9. Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche. L’intelligence artificielle dans les établissements scolaires, sur le plan administratif et pédagogique. mai 2025.
10. MIA second. [En ligne] https://miaseconde.fr/blog/lancement-de-lexperimentation-de-mia-seconde-en-academies.
11. Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Cadre d’usage de l’IA en éducation. 2025.
12. CNIL. FAQ CNIL. [En ligne] https://www.cnil.fr/fr/enseignant-usage-systeme-ia.
13. De Vinci et Talan. L’impact des IA génératives sur les étudiants. avril 2024.
14. Exploring Parent-Child Perceptions on Safety in Generative AI: Concerns, Mitigation Strategies, and Design Implications. Yaman Yu, Tanusree Sharma, Melinda Hu, Justin Wang, Yang Wang. [éd.] arXiv. octobre 2024.
15. Common Sense Media. The Dawn of the AI Era: Teens, Parents, and the Adoption of Generative AI at Home and School. 2024.
16. 20 minutes – OpinionWay. Étude #MoiJeune. octobre 2024.
Partie 2
17. Emerging AI-Individualism: How Young People Integrate Social AI into Their Lives. P. Brandtzæg, Marita Skjuve, Asbjørn Følstad. 2024, Social Science Research Network.
18. A Study on the AI-Powered Social Media and Its Effects on Adolescent Mental Health. Sharma, Rakhi. 2024, Gurukul International Multidisciplinary Research Journal.
19. Artificial Intelligence, Social Media, and Modern Teenagers. Hanifah Hikmawati, Mega Putri Aulia Darma. 2025, INCARE, International Journal of Educational Resources.
20. Navigating the Digital Maze: A Review of AI Bias, Social Media, and Mental Health in Generation Z. Jane-Pei-Chen Chang, Szu-Wei Cheng, Steve Ming-Jang Chang, Kuan-Pin Su. 2025, Applied Informatics.
21. The Rise of AI Companions: How Human-Chatbot Relationships Influence Well-Being. Zhang, Yutong, et al. [éd.] arXiv. juin 2025.
22. États-Unis : Chat GPT responsable du suicide d’un ado ? France Info. août 2025.
23. Exploring the Role of AI-Powered Chatbots for Teens and Young Adults with ASD or Social Anxiety. Mian, Dilan. [éd.] arXiv. décembre 2024.
24. Bristol, University of. Algorithmic literacy must improve to support young people’s wellbeing. 2025.
25. Diplomeo. Les 16-25 ans et l’intelligence artificielle. avril 2024. Enquête.
26. IFOP pour Talan. Baromètre 2025 – Les Français et les IA génératives. avril 2025.
27. The Bias Amplification Paradox in Text-to-Image Generation. Seshadri, Preethi, Singh, Sameer et Elazar, Yanai. [éd.] Association for Computational Linguistics. juin 2024, Vol. Proceedings of the 2024 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (Volume 1: Long Papers).
28. Perpetuation of Gender Bias in Visual Representation of Professions in the Generative AI Tools DALL·E and Bing Image Creator. Sandoval-Martin, Teresa et Martinez-Sanzo, Ester. 5, s.l. : Social Sciences, mai 2024, Vol. 13.
29. University, Charles Sturt. Generative AI creates gender bias – new study reveals. septembre 2024.
Références
- 1Logiciel qui simule le dialogue en langage naturel avec l’utilisateur.
- 2Terme mélangeant « Deep Learning » et « Fake », qui désigne un enregistrement vidéo ou audio réalisé ou modifié grâce à l’intelligence artificielle. En fait, il fait référence à des contenus faux qui sont rendus crédibles par l’effet de l’intelligence artificielle.
AUTRES CONTENUS SUR CE THÈME

La création littéraire au défi de l'IA N° 195, septembre 2025
Née de nos rêves de communiquer avec d’autres espèces, l’intelligence artificielle (IA) questionne autant notre…
Voir le produit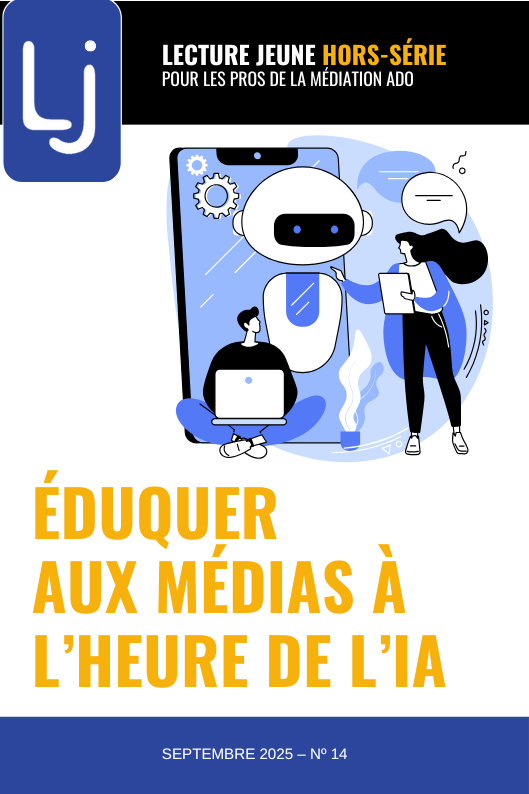
Éduquer aux médias à l'heure de l'IA, Hors-série N° 14, septembre 2025
L’intelligence artificielle vient bouleverser les pratiques de médiation et notamment dans le domaine de l'éducation…
Voir le produit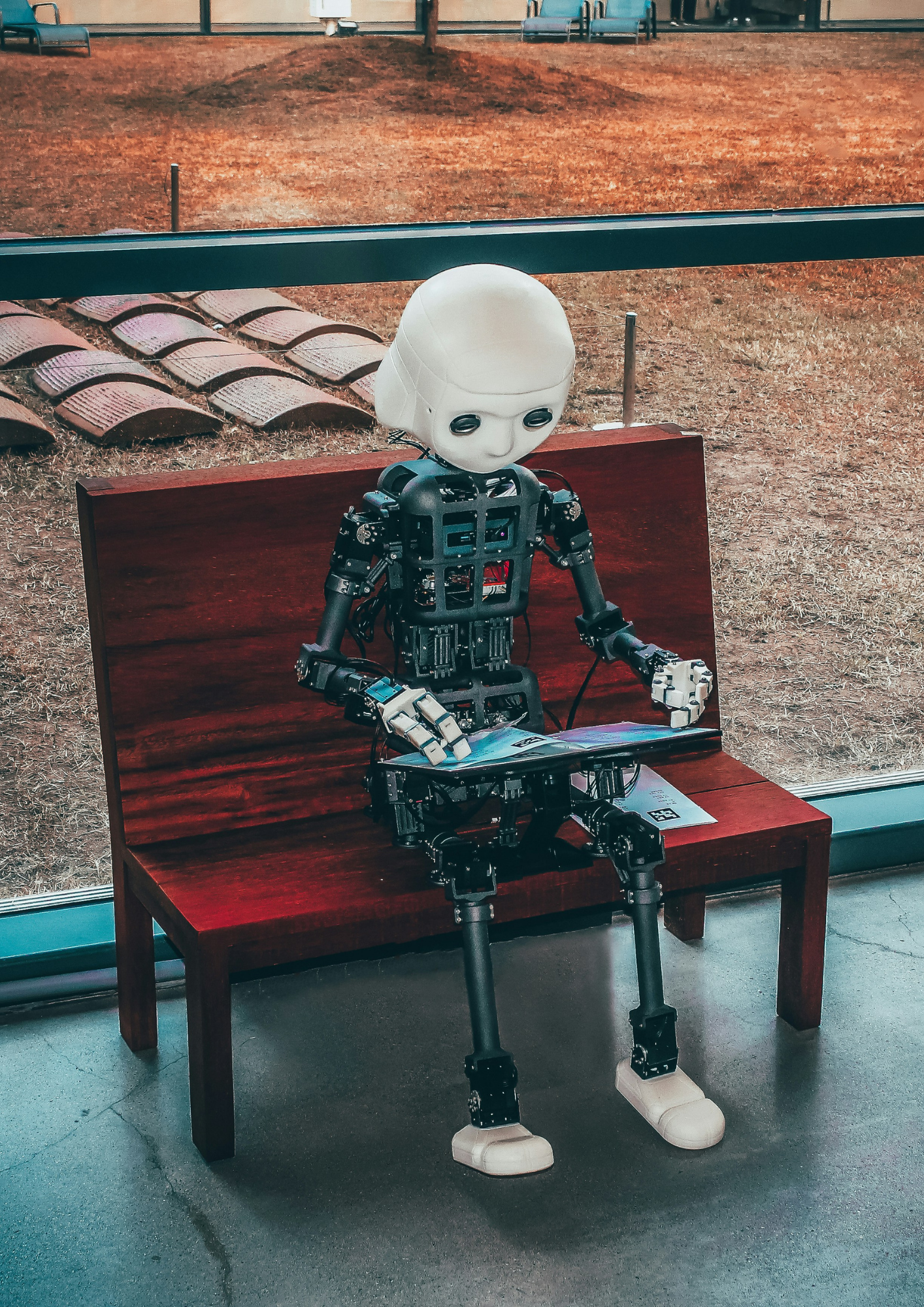
Formation sur site : Découvrir les intelligences artificielles (IA) et leurs enjeux aujourd'hui, en mobilisant les collections ados/jeunes adultes
Résumé. Questionnées depuis des décennies dans les littératures ados, les intelligences artificielles font aujourd’hui partie intégrante…
Voir le produit
Numook : Projet pour valoriser la créativité des adolescents
Rendre les jeunes acteurs de leurs apprentissages. Un programme où les élèves créent un livre numérique enrichi de sons et d'images. Un…
Voir le produitPOUR ALLER PLUS LOIN

L’influence des objets et des pratiques culturelles sur l’orientation des filles dans des filières scientifiques
Par Observatoire de la lecture et de l'écriture des adolescents , Clémence Perronnet
Pourquoi l’enquête ? Malgré des progrès incontestables ces dernières décennies, les femmes restent minoritaires dans…
Lire le rapport
L’intelligence artificielle générative : Un nouvel acteur de la désinformation ?
Par Agathe Franck
Le 9 janvier 2025, l'Observatoire de la lecture et de l'écriture des adolescents de Lecture…
Lire l'article
Le numérique au service des apprentissages pour les collégiens et les lycéens, interview de Pascal Cotentin
Par Sonia de Leusse-Le Guillou
Pascal Cotentin. Michael Stora (voir l'article "L'adolescence à l'épreuve du virtuel, entre construction identitaire et excès") mentionnait la…
Lire l'article
Amener les adolescents à la lecture : la mission de Lecture Jeunesse
Par Camille Vincent
Intelligence artificielle et lecture des adolescents : une priorité renforcée. L’année 2024 marque une étape majeure pour Lecture Jeunesse, association qui célèbre son cinquantenaire en…
Lire l'article