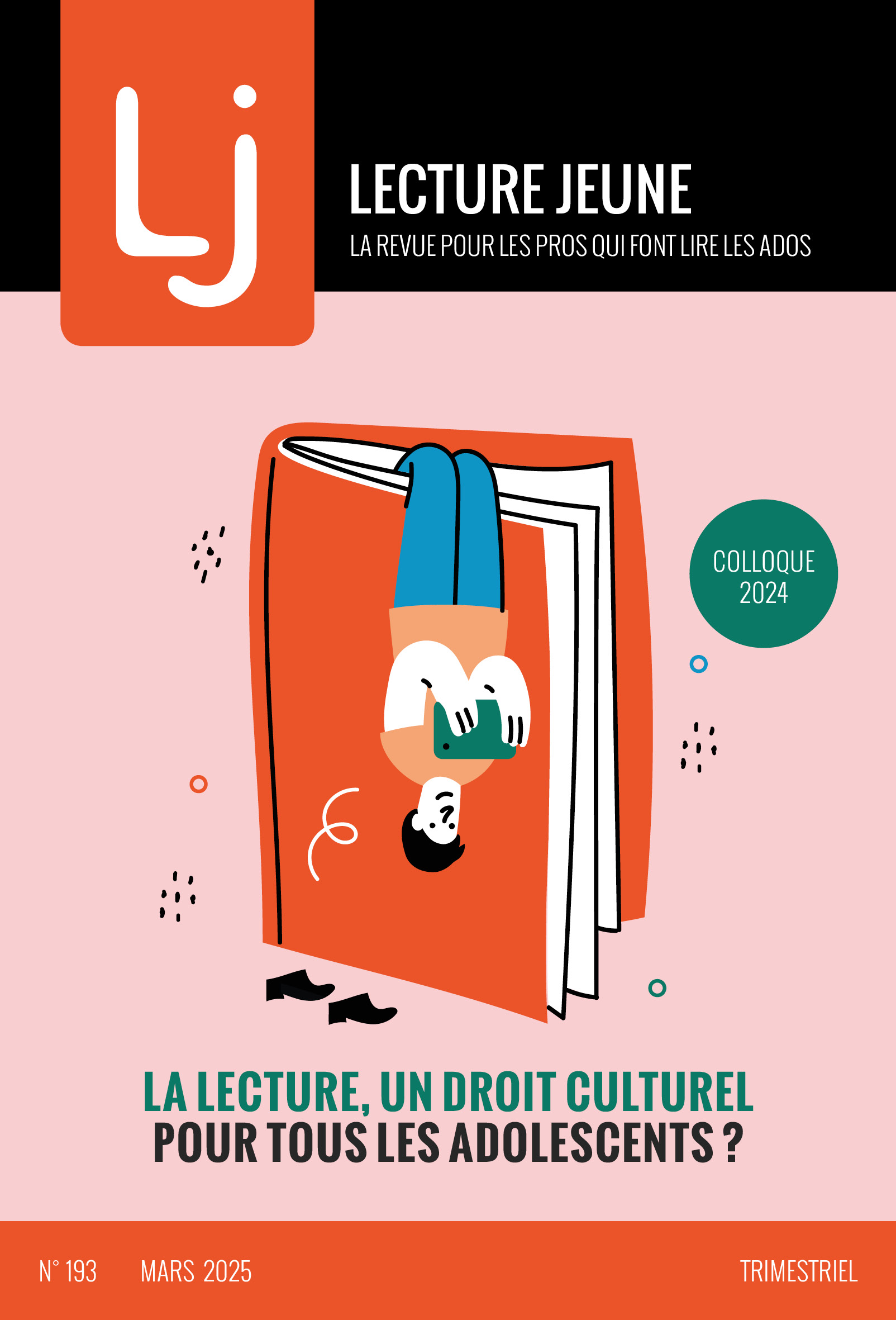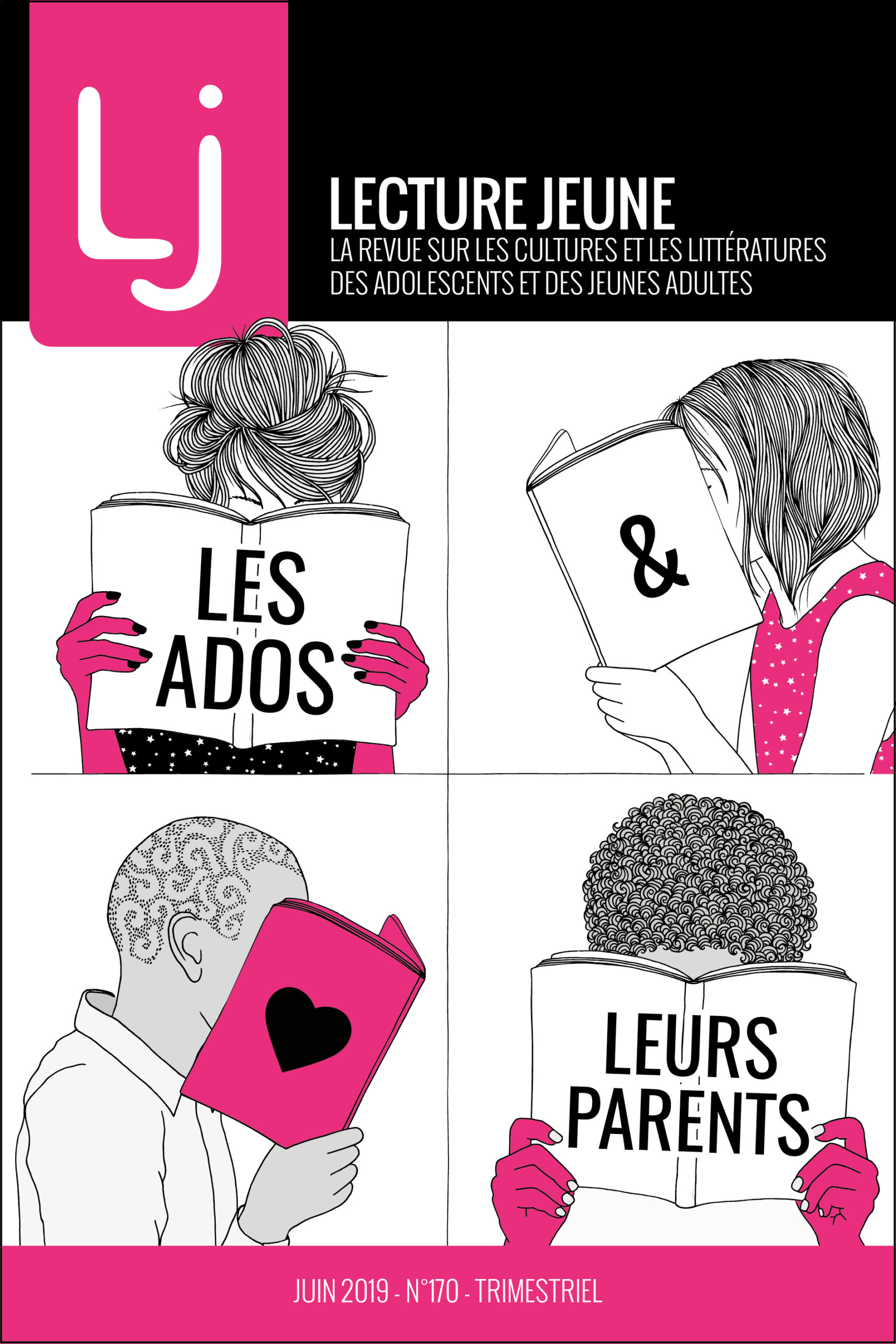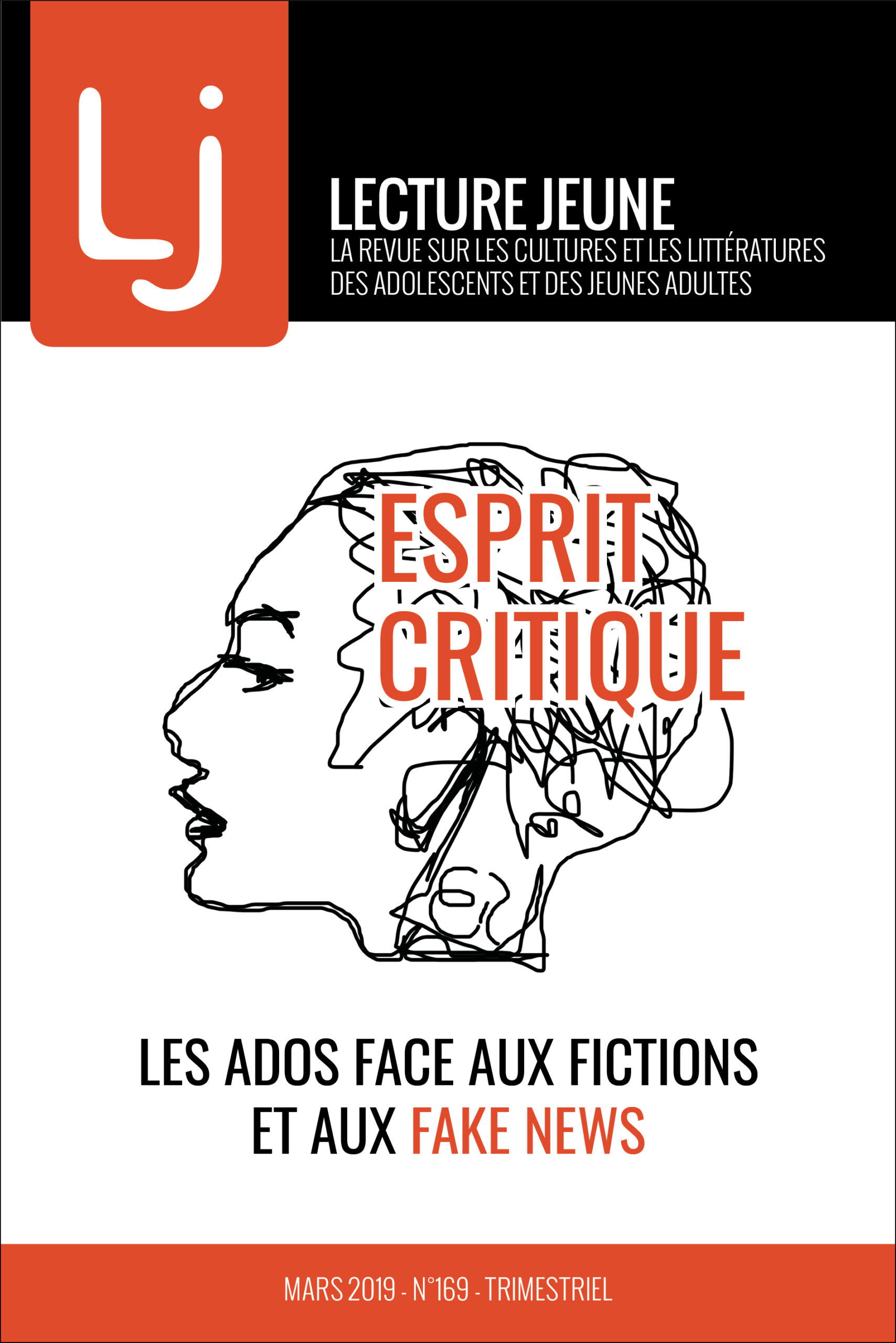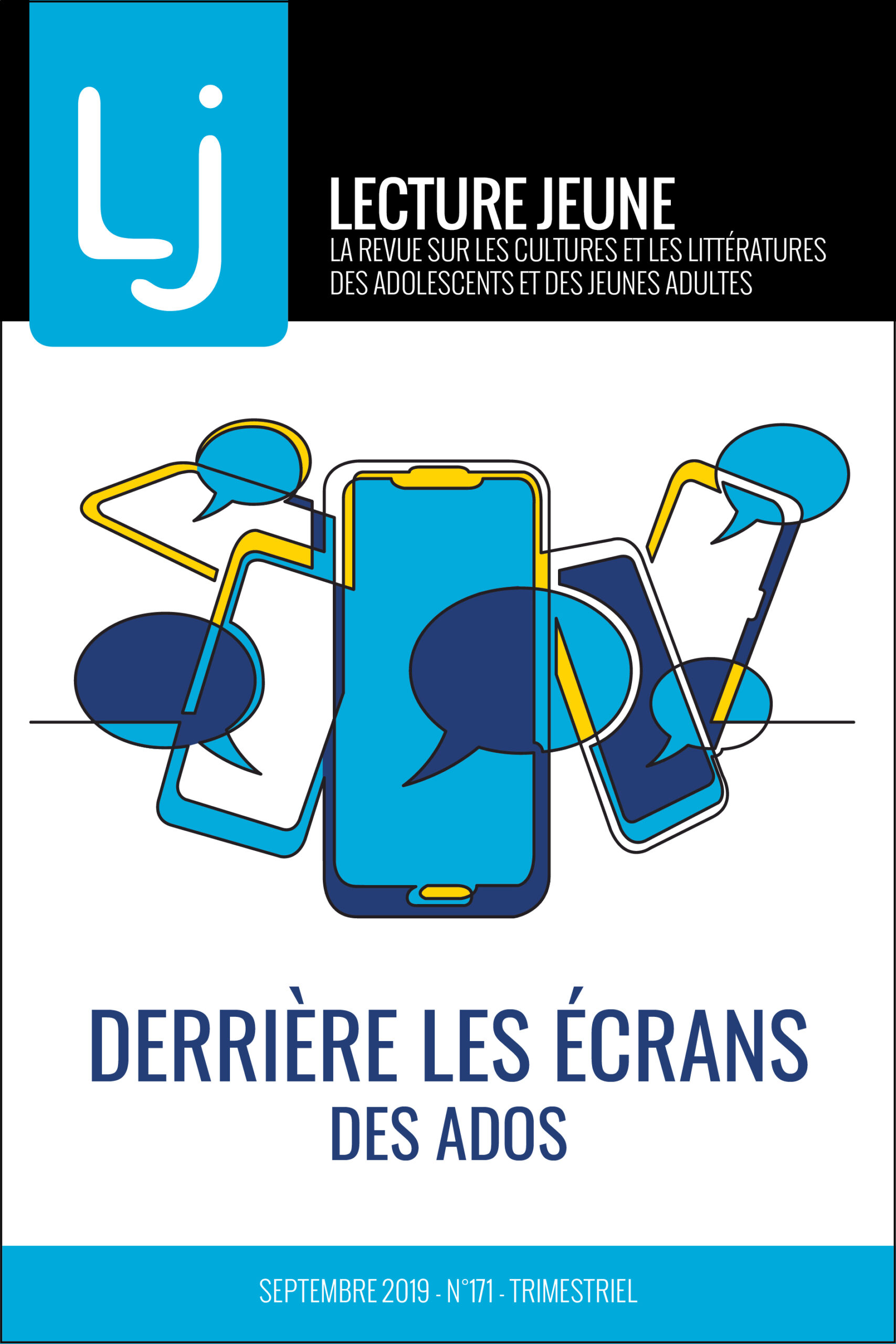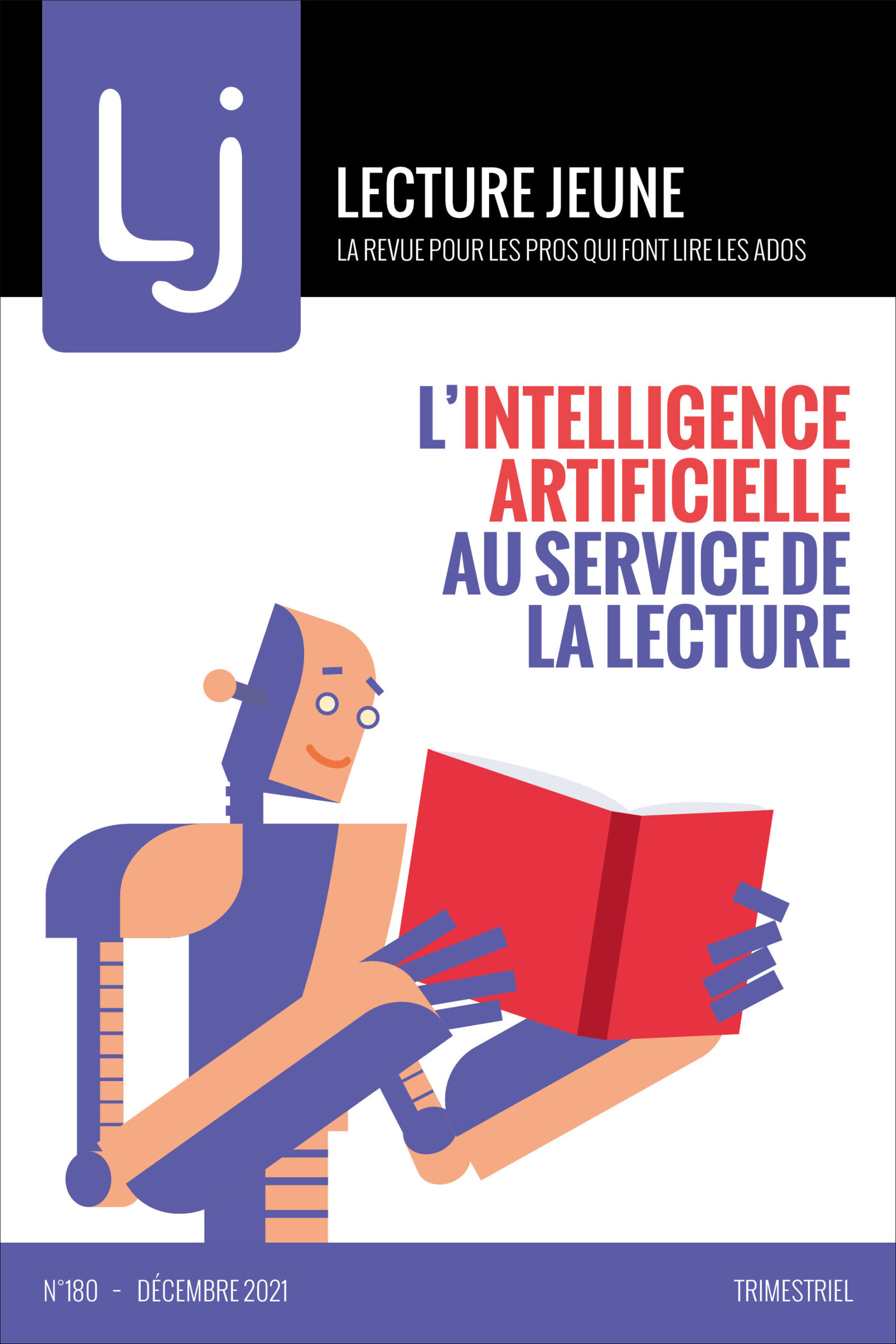Description
Selon l’article 31 de la Convention internationale des droits de l’enfant, chaque enfant a le droit à la lecture et à participer librement à la vie culturelle et artistique. Qu’en est-il réellement ? La question du droit à la lecture induit celles des lectures : à quels livres les adolescents ont-ils accès ? Par ailleurs, les nouvelles plateformes de préconisation littéraire ouvrent de nouveaux horizons littéraires à explorer et à comprendre. Quels livres souhaitent-ils lire et en quoi leurs préférences redéfinissent-elles le champ de la littérature ?
Rassemblant des contributions du colloque de l’Observatoire de la lecture et de l’écriture des adolescents qui a eu lieu le 20 novembre 2024 au Parlement européen et des articles inédits, ce numéro spécial dresse un état des lieux de la véritable accessibilité des livres et des lectures et de la recherche sur la question. Chercheurs et professionnels de la question proposent des pistes de médiation concrètes pour faire vivre ce droit au quotidien, et garantir la liberté des jeunes à lire.
Axe 1. Pour le droit des adolescents à la lecture
Dans ce premier mouvement de réflexion, il s’agit d’abord d’interroger la notion même de droits culturels, en distinguant les notions de démocratie culturelle et de démocratisation culturelle, sans oublier la question de l’impact des transformations structurelles sur le rapport des jeunes à la lecture grâce aux apports des travaux d’Olivia Guillon (économiste) Sylvie Octobre et Anne Jonchery (sociologues de la culture).
Et, en pratique, qu’en est-il du droit culturel ? Quels accès aux livres pour les adolescents les plus en marge ? Pour répondre à ces questions, vous pourrez retrouvez les contributions de professionnelles de terrain : Cécile Arnoult (linguiste et fondatrice des Éditions Kiléma) qui élargit les frontières de la littérature en essayant de l’ouvrir aux lecteurs empêchés, grâce au FAcile à Lire et à Comprendre, Frédérique Fisson (enseignante) parle de l’engagement de son association ATD Quart Monde, qui fait vivre les bibliothèques au-delà des murs à la rencontre des personnes en situation de pauvreté, Cécile Perret (enseignante en établissements pénitentiaires pour mineurs), qui travaille au quotidien à garantir le droit à la lecture pour ceux qui sont privés de liberté à l’âge où ils ont besoin de repères pour se construire.
Axe 2. Littératures, littéracie : quels accès à la diversité des textes ?
Nous cherchons à garantir le droit des adolescents à la lecture : mais de quelle lecture parle-t-on ? Dans ce deuxième mouvement de réflexion, des chercheurs et chercheuses français et européens livrent leurs réflexions sur la diversification nécessaire des lectures pour défendre pleinement la liberté des ados à lire. Christophe Ronveaux (enseignant-chercheur en didactique de la lecture) et Juliette Renaud (enseignant-chercheure en sciences de l’éducation) ont fait part de leurs recherches en cours sur la nécessité de la place des lectures non patrimoniales dans le cursus scolaire, tandis que Daniel Delbrassine (enseignant-chercheur en didactique du français et de la littérature jeunesse), Hans Lösener (professeur de langue et littérature allemande) et Pierre Outers (didacticien du français) nous décrivent des systèmes belges et allemand qui nous pousse à repenser le programme scolaire dans L’Hexagone.
Axe 3. Influence, médiation, préconisation : les nouvelles façons de faire lire
Enfin, la question de l’accessibilité des lectures induit celle de la préconisation, renouvelée aujourd’hui. Marine Siguier (enseignant-chercheure en sciences de l’information et la communication), présente ses réflexions sur les nouvelles voies de la prescription littéraire sur les réseaux sociaux (son livre Des Livres et des likes est à retrouver ici). Face à ces transformations, Laure Pillot (enseignante et formatrice Inspé) offre des pistes de renouvellement de nos pratiques de médiation afin de s’adapter au monde d’aujourd’hui et à celui qui vient.
Enfin, Anne Vibert (anciennement maîtresse de conférences en littérature) reprend de manière synthétique la question de l’accessibilité des livres, en rappelant l’une des contraintes majeures : celle des moyens matériels.
Ce numéro de Lecture Jeune fait le point sur ce droit à la lecture que nous nous devons de porter haut afin de le garantir au quotidien en tant qu’acteurs et actrices du monde de la médiation culturelle.
FAIRE DÉCOUVRIR
Retrouvez, dans la partie CRITIQUES de la revue, les avis de notre comité de lecture des livres qui ont marqué la littérature adolescente ces derniers mois. Parmi eux, nous retenons : le roman d’anticipation Demain n’aura pas lieu, de Illuna Allioux, « une histoire atypique entre récit apocalyptique et roman initiatique », Verts, bande dessinée dystopique de Patrick Lacan, dans laquelle les personnages « évoluent dans un monde où la nature a repris ses droits » ou encore, pour le Printemps des poètes, Signe-moi que tu m’aimes, de Levent Beskardès, dont « la poésie traduit en effet une perception du monde précise, sensible, décalée ».
Informations complémentaires
| Format | Numérique, Papier |
|---|