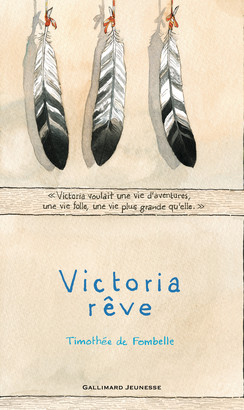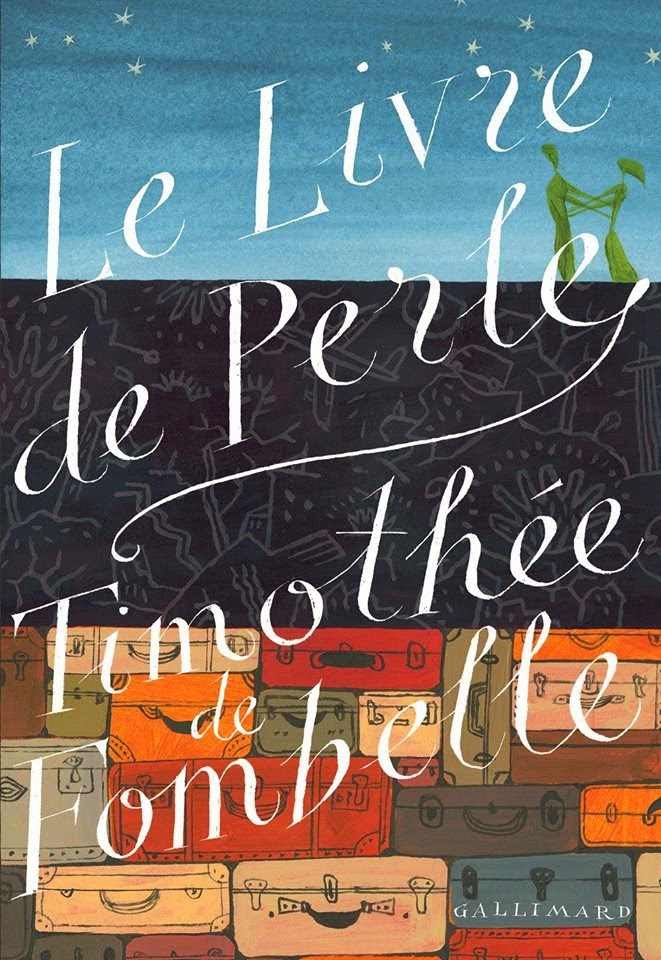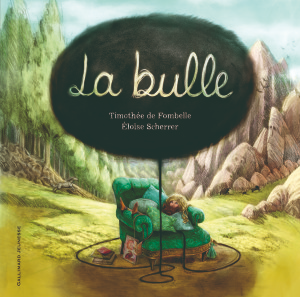C’est dans son atelier que Sonia de Leusse-Le Guillou et Marieke Mille ont rencontré Timothée de Fombelle. L’auteur du Livre de Perle, lauréat des Pépites 2014, partage son expérience d’écrivain.
Marieke Mille : Tobie Lolness est un enfant, Vango un adolescent, dans Le Livre de Perle les personnages sont adultes. Pourquoi cette avancée en âge ?
Timothée de Fombelle : Contrairement à J.K. Rowling qui affirmait suivre l’âge de ses lecteurs, je n’ai pas l’impression d’appliquer cette stratégie consciemment. Je constate effectivement que les personnages grandissent, les lecteurs aussi d’ailleurs. La progression en âge des héros représente un moyen d’explorer de nouvelles pistes puisqu’elle transforme le regard sur ce que je raconte. Elle me permet aussi de faire évoluer la langue et l’écriture. Dans chaque livre, j’essaye d’inventer un langage propre, même si j’espère qu’un unique auteur est reconnaissable sur l’ensemble. Cette avancée en âge vient d’une envie de variété, je voudrais cependant interrompre ce mouvement. Je réalise que je suis désormais attendu sur un livre pour adultes, alors que je souhaite au contraire tirer sur la corde à nœuds pour revenir vers les jeunes lecteurs. Je vais publier un album illustré(1) pour bien rappeler que j’écris pour les enfants. Pour mes prochains livres, je désire m’adresser aux lecteurs de Tobie Lolness, ceux qui m’ont confié vivre avec ce roman leur première grande aventure et avoir découvert la lecture, qui les accompagne de jour en jour. J’espère en être capable. Cela implique aussi de mettre de nouveau en scène des personnages un peu plus jeunes même si j’ai toujours tendance à dire le moins possible l’âge ou l’apparence des héros pour laisser la place à l’imagination.
MM : Vos personnages ont pour point commun d’être des exilés, des déracinés.
TF : Cette thématique me passionne. Pourtant, je ne connais pas grand monde qui ait autant de racines que moi, qui suis plutôt sédentaire ! J’ai eu l’impression d’être en exil par moments en vivant à l’étranger. Quand j’ouvrais alors des livres, en particulier ceux du patrimoine, je les redécouvrais. Pour moi, l’exil transforme le regard. Le voyage un peu long et la séparation créent une distance bénéfique sur le monde natal. Dans mes textes, je parle plutôt d’exils subis, parfois rudes, qui impliquent des ingrédients passionnants pour la mécanique de l’auteur : la découverte d’un autre monde, l’aventure, l’inconnu, la quête, le passé embelli et la nostalgie. Je me sers de ce sentiment pour rappeler vers quoi court mon personnage. Ma narration n’est pas chronologique car j’ai besoin de remettre des pelletées de ce charbon dans le moteur en évoquant des souvenirs qui donnent envie de retrouver ce bonheur perdu. Ces éléments créent l’énergie du retour, le désir de découvrir la solution et de retrouver les origines. Ce n’est pas simplement une manie personnelle, le « cuisinier » que je suis trouve aussi que c’est un bon ingrédient pour réussir un roman. Mes projets ont néanmoins presque tous cette dimension donc c’est plus grave que ça en a l’air ! Tout cela n’est pas que technique, je suis déchiré par tous les récits d’exils.
Sonia de Leusse-Guillou : Vos personnages sont métamorphes. Ils ne se transforment pas physiquement, mais ils possèdent plusieurs identités – qu’ils ne connaissent pas forcément eux-mêmes ! Entre Vango, prêtre puis criminel, Illian qui est pris pour une fille, mais décrit avec beaucoup de métaphores animales, Céleste, qui représente la Terre à part entière, vos personnages ont de multiples facettes perçues différemment par les autres. Eux-mêmes se cherchent toujours.
TF : Effectivement, ils se transforment et c’est grâce à cette capacité et surtout à la difficulté qu’on a à les attraper qu’ils sont des héros. Même si je suis fasciné par Zorro et par les super héros, je n’ai pas envie d’une transformation façon Marvel, comme Hulk qui devient vert ! Je ne donne pas de visage aux personnages, ce qui conforte ce côté « impossible à attraper ». Il y a aussi une volonté d’universalité, une sorte d’ambition de toucher chacun et de profiter de cette liberté de l’écriture laissée par le roman dans lequel il n’est pas nécessaire de trancher : le lecteur peut finir le travail. Il m’arrive de créer des coquilles vides pour laisser la place aux lecteurs, mais de manière inconsciente, parce que nombre d’entre eux ont l’impression que j’étais très précis quand ils ont eux-mêmes rempli les blancs. Je veux profiter de ce bonheur du livre qui peut aller cueillir les rêves de chacun. Un épisode que je raconte souvent dans les classes, m’a beaucoup marqué : un jeune avait l’impression que Vango volait au-dessus de Paris. J’ai retrouvé ce passage dans lequel je dis qu’ « il sautait plus léger que l’air ». Je suis émerveillé qu’on ait choisi d’en faire un personnage qui vole. Cela me touche d’avoir pu laisser cette possibilité tout en permettant au lecteur réaliste d’avoir aussi sa vision.
SLG : C’est amusant que vous citiez cette anecdote sur un Vango qui vole : vous parlez de coquilles vides, je dirais plutôt des bulles. Ce qui me frappe, c’est le côté extrêmement aérien et léger des personnages et l’importance de l’envol. Peut-être est-ce abusif de passer de votre anecdote sur le vol de Vango au-dessus de Paris à Vol au-dessus de Vitebsk de Chagall, mais il me semble que ce rapprochement fait également écho à ce que vous disiez sur l’importance de l’exil. Pour ce qui est des personnages aériens, je pense à Céleste (par son nom), à Vango dont vous dites que c’est un héros aux semelles de vent, Olia dont les pieds ne s’enfoncent pas dans le sol(2), Ilian (c’est un courant d’air dans son royaume, il soulève la neige en silence ; pas un souffle, pas un bruit à son passage), Tobie (si minuscule et léger qu’il pourrait s’envoler). Vous avez le Zeppelin et le Zéphyr(3)… Ces personnages-plumes sont tout aussi présents que, comme vous le disiez, insaisissables. Ce sentiment de légèreté, d’envol, va-t-il de pair avec l’exil ? Qu’est-ce que cela représente pour vous ?
TF : C’est vrai que je n’avais pas pensé à ce lien avec l’exil ni, effectivement, à Chagall – ou à des personnages de Joann Sfar, qui sont très chagalliens. A mon avis, il s’agit encore d’une manière de sortir du réel, qui me passionne. La petite liberté que je donne à mon personnage par rapport au réalisme, c’est cette légèreté, cette facilité ; qui est pour moi la définition de l’écriture : on peut y mettre plus d’air, plus de souffle, plus de vent, plus de hauteur que dans la vie. Donc je m’engouffre (encore un mot adapté) dans cette possibilité que donne le livre par rapport au réel. C’est pour cela, aussi, que j’aime cette littérature jeunesse ou cette littérature de l’imaginaire en général. Elle me tire vers le haut. Ce genre lui-même me donne le devoir de la légèreté. J’y vois probablement aussi une fuite du réel, de la pesanteur, et un petit message pour donner de l’espace, de la grandeur à mes jeunes lecteurs. Même si nous nous donnons l’impression d’être virtuels par la communication incroyable, par les mondes parallèles ou fictifs dans lesquels nous vivons, dans des jeux, dans des identités autres, j’ai l’impression que nous avons quand-même des semelles de plomb. J’ai envie de leur donner une autre légèreté, un autre élan, une autre image du héros.
MM : Pour autant, l’écriture est très sensorielle on trouve des références à beaucoup d’odeurs, de nourriture : on a envie de manger des guimauves, la cuisine de Mademoiselle de Vango nous fait saliver …
TF : Oui, Mademoiselle cuisine un plat qu’il faut retenir pour ne pas qu’il s’envole tellement il est léger. Les sens me permettent de tisser un lien avec le réel pour jeter mon filet sur le lecteur. Par des mécanismes assez proches de ceux de l’hypnose, convoquer une communauté de souvenirs sensoriels me sert à faire passer les éléments moins crédibles. Il faut croire à l’itinéraire de Vango, à sa généalogie compliquée, à son parcours, à sa manière de grimper Notre Dame, mais à partir du moment où on reconnaît le goût de la feuille de laurier dans la pomme de terre, on se dit que c’est peut-être vrai. De la même manière, la micro-sagesse ou la philosophie que j’ose, sont des moyens de nouer la confiance. Un élément déjà ressenti ou déjà vécu par le lecteur permet de raconter des histoires complètement folles et de toujours l’avoir avec soi. Je pense beaucoup à mon lecteur finalement, ce qui n’est pas très noble dans la conception de la littérature comme un travail de soi avec soi qui nous est arraché pour devenir un livre. En commençant par le théâtre, j’ai échappé à cette vision. On peut un certain temps écrire une pièce pour la jouer tout seul avec ses petits soldats de plomb, et je l’ai fait, mais le texte a quand même vocation à être partagé et prolongé sur scène. Le domaine que je veux explorer dans l’écriture est celui d’une littérature très tournée vers son lecteur.
MM : La fiction et le réel sont très poreux dans Le Livre de Perle. Votre atelier devient la boutique de guimauves des Perle. A quel moment ce lieu s’est-il transposé dans la fiction ?
TF : Très vite. J’y avais déjà placé le restaurant du second tome de Vango, même si je le localise très peu. J’évoque une file d’attente qui passe dans la rue jusqu’au carreau du temple. J’adore créer des liens avec des vrais lieux sans le mettre en avant. De la même manière, des appuis de réalité ou des personnages réels, connus ou non, passent dans mes romans. La boutique était importante autant pour la fiction que pour le réel mais la fiction se nourrit ainsi de beaucoup de réalité. Le chapitre qui commence à une heure un peu creuse un jour où il fait beau, est alimenté par ce que je vis. Si ce n’était pas le cas, je ne l’aurais probablement pas écrit. Comme j’avais toujours travaillé en nomade dans des bibliothèques, j’avais aussi besoin de m’enraciner dans ce lieu. Choisir de m’installer dans un atelier m’a amené à lui inventer une histoire pour qu’il devienne un endroit un peu imaginaire, mon propre petit monde. Ce besoin rejoint aussi le théâtre, les décors. J’avais essayé de trouver des figures de collectionneurs des reliques sorties des contes de fée. Je me suis notamment plongé dans les carnets de Léonard de Vinci qui sont un peu brouillons. Des listes y figurent, dans une marge, il est écrit : « un chaperon usagé, des bottes.. ». Je suis certain qu’il était le premier collectionneur, ce qui ne m’étonnerait pas parce qu’il était très étrange ce bonhomme. J’ai cherché ces traces dans les recueils de contes même si je n’avais pas du tout l’intention de m’en servir. Je ne voulais pas le citer parce que je trouvais que ça faisait Da Vinci Code !
Je me reconnais davantage dans le réalisme poétique ou dans le réalisme magique, éventuellement.
SLG : Vous auriez pu développer des univers parallèles. A l’inverse, dans tous les livres, le merveilleux vient se glisser dans la réalité, qui a des portes, des trappes, des interstices. Vous conduisez le lecteur vers une forme de réalisme poétique, beaucoup plus que vers un univers imaginaire.
TF : Absolument. J’ai vu ce matin que Le Livre de Perle était sélectionné pour le grand Prix de l’imaginaire or, je me sens pas très bien armé parce que ses membres sont des puristes de la fantasy, de la science-fiction, même s’ils avaient toléré Tobie. Je me sens très marginal dans le monde de l’imaginaire, notamment parce que je n’en possède pas la culture. Je ne suis pas, comme beaucoup de mes amis auteurs, issu du monde des jeux de rôles, de cette culture incroyable qu’ils ont de la fantasy ; je ne sais même pas bien la définir. Je suis tout à fait d’accord avec vous : je me reconnais davantage dans le réalisme poétique ou dans le réalisme magique, éventuellement − qui est plus l’affaire de l’écriture que de l’univers décrit, qui est plus une écriture qui transforme le réel ou qui poétise le réel − plutôt que dans la construction de mondes imaginaires. Si je devais changer, je préférerais faire du documentaire, de l’enquête, du journalisme. J’ai l’impression que c’est cela ou rien ; dans mon cas c’est tout ce que je peux apporter. C’est ce que je découvre en ce moment, en développant des projets audiovisuels : je travaille sur une série télévisée depuis quelque temps. Comme j’ai reçu l’aide à la création du CNC pour écrire l’épisode pilote de cette série, je me retrouve à dialoguer avec des producteurs ou avec des chaines sur des questions de crédibilité, de cohérence, qui ne sont, pour moi, qu’une étape intermédiaire, alors que j’ai sans arrêt envie de leur dire « ce n’est pas crédible, mais attendez, je vais vous le faire croire ! ». De même que, quand je retrouvais mon éditeur et que je lui racontais mon histoire, il me soutenait mais je sentais qu’il ne voyait pas très bien où j’allais. Je sentais que tel que je décrivais le livre, il pouvait devenir une usine à gaz infernale ! Sur le papier, il n y a pas une critique du Livre de Perle qui ne commence pas par « impossible de résumer correctement cette histoire » − pourtant, certains y parviennent. Dans un projet d’écriture, pour moi, rien n’a vraiment commencé tant que je n’ai pas tenté d’écrire quelques pages. C’est l’étape fondatrice du projet.
MM : Vous avez réuni les valises, les reliques des contes de fées, les photos qui se sont ainsi matérialisées dans le réel. Pour quelle raison avez-vous rassemblé ces éléments ?
TF : J’avais besoin de créer des choses qui me résisteraient moins que les mots. Lorsque je pars aux puces pour trouver des valises, je sais que je ne reviendrais pas les mains vides. J’ai besoin de quelque chose qui avance inexorablement. J’aime la menuiserie, fabriquer des meubles, pour cette raison. C’est un équilibre personnel. Je fais un métier, si j’ose dire, un peu plus cérébral que ma vraie nature, en plus d’avoir ressenti le besoin d’inventer des racines au lieu comme je le disais. Je parle beaucoup de l’appartement au-dessus de la boutique, mon rêve serait de récupérer l’appartement des Perle, parce que c’est comme si on me l’avait volé. Ce n’est pas anodin si j’ai placé cet appartement à cet endroit ; j’avais la petite poche de mystère qu’il me fallait pour écrire.
MM : Dans Victoria rêve, le personnage rêve le monde. Le Livre de Perle est presque dans une antithèse puisqu’il faut recréer l’imaginaire à partir du réel.
TF : Le réel entre dans la vie imaginaire de Victoria, qui a complètement phagocyté son quotidien. La situation de son père devient plus extraordinaire que l’imaginaire, ce qui lui permet de grandir, de revenir à la réalité. Dans Le Livre de Perle au contraire, l’imaginaire entre dans le réel, dans ma vie, même si ça tombe très mal parce que Perle a besoin de moi pour raconter son histoire et que je ne suis plus crédible depuis que j’en écris. La vocation du livre est un peu de faire croire à ce que je raconte tout en sachant qu’on ne croira pas complètement. Les constructions sont un peu inversées, mais pour écrire, il faut vraiment faire la part entre réel et imaginaire, sinon le texte risque d’être vaporeux. Pour la première fois, je mets de la magie dans un roman sans l’avoir prévu, mais la nécessité de l’histoire m’a obligé à créer une fée. J’ai lu beaucoup de contes pour en retrouver la langue, mais j’ai voulu inventer ma propre manière de les raconter. Si elle est un peu solennelle au début, j’ai cherché à la faire rentrer progressivement dans du roman, de la poésie. De la même manière que lorsqu’on passe du noir et blanc à la couleur dans les films, cette transformation s’opère par l’écriture. La présence du merveilleux dans mes histoires est accidentelle. J’ai plutôt envie de revenir à cette poésie du réel. Je voulais cependant régler son compte aux origines du récit épique dans la tradition orale qui m’a nourri, pour me rappeler d’où tout cela vient.
SLG : D’où tout cela vient-il, justement ? On retrouve un peu de science-fiction chez Céleste, des réminiscences de L’écume des jours. Tobie Lolness n’est pas étranger à Alice au Pays des merveilles. Vous citez Le dormeur du Val, Le Comte de Monte Cristo, pour Vango tandis qu’on pense aussi à Tristan et Iseult, puis aux contes avec Le Livre de Perle… Qu’est-ce qui compose votre univers intérieur ? Vous reste-t-il des mots, des vers, des passages de livres en mémoire ? Est-ce plutôt une musique des mots, une atmosphère, une tonalité orale, qui vous habitent ? Comme beaucoup d’écrivains, votre écriture relève du palimpseste. Quel pourrait être son déclencheur ?
TF : Je pense qu’effectivement, c’est assez oral ou musical, même si je ne suis pas un très grand musicien du tout. Mais en ce qui concerne la langue, je reconnais très souvent en écrivant « les sous-couches », ce palimpseste dont vous parliez. Je sens du Cyrano, je sens effectivement du Rimbaud, je joue aussi, quand j’entortille un peu les phrases en escargot, au micro-Proust. Alors oui, c’est vraiment musical et c’est la chanson de la langue qui me tient. Je me souviens quand je me suis autorisé à prendre la voie du lyrisme, à reprendre des motifs, alors que j’étais auparavant, systématiquement, sur l’idée du chemin unique, le moins fréquenté, celui qui n’existe pas avant moi et disparait après moi, d’une écriture très plastique, tendue, un peu difficile. J’ai eu vraiment un déclic, provoqué d’ailleurs par une réécriture que je peux dater exactement, lorsque je travaillais sur La Bible. J’avais cette commande sur un texte qui, de toute façon, n’était pas le texte original. Je me suis permis d’écrire : je me rappelle une sorte de plaisir interdit à raconter généreusement, de la meilleure manière possible, sans chasser les fantômes qui nous ont nourris, qui nous ont fait grandir. Faire retomber l’ego de l’écriture m’a permis de me trouver. La forme « cubiste » que j’adoptais tournait autour de l’objet. Je me suis rendu compte que ce n’était pas moi, et que cela relevait plus d’un principe que de mon envie de raconter des histoires. Bien sûr, j’ai besoin que mon écriture soit reconnaissable, de créer ma patte malgré tout. C’est intéressant parce que c’est vraiment en vous répondant que je réalise la place de la musicalité.

SLG : Le rythme est très important dans vos livres, le tempo…
TF : Ils le sont, oui. Jean-Philippe Arrou-Vignod me dit parfois qu’il voit un petit quelque chose de Victor Hugo en lisant mes textes, dans Vango par exemple, qui commence à Notre Dame. Et cela ne m’étonne pas tant que cela parce que Ruy Blas, et plus largement le théâtre de Victor Hugo, m’ont nourri. J’ai des enregistrements de Gérard Philippe, par exemple, dans Ruy Blas, ou de Lorenzaccio de Musset. Mais la comparaison s’arrête évidemment à cette petite musique commune ! Je ne boxe pas dans la même catégorie! Il y a, pour moi, une sorte d’audace à oser le lyrisme, à oser le classicisme. L’humour permet ensuite de dédramatiser le texte. Il représente mon plus grand défi, parfois impossible. Une fois mon plan terminé, je me dis toujours qu’il faut absolument que le texte soit drôle. Parfois, un commissaire Boulard (Vango) m’aide beaucoup. Dans Le Livre de Perle, c’était un peu ma fonction à travers mon regard Woody Allenien, mon apparition comme personnage, comme une sorte de clown – mais ce n’est pas évident !
MM : Cet auteur qui apporte la touche humoristique, court pendant tout le roman après son personnage. N’est-ce pas un peu métaphorique ? Parce que monsieur Perle a été très énigmatique pendant longtemps…
TF : Oui, bien sûr, il s’agit de toute façon l’histoire d’une histoire. Dans ce roman, on peut replacer la temporalité de vingt-cinq ans de ma vie sur les quelques années de l’écriture à partir de la rencontre avec le personnage. J’ai toujours été fait de premières rencontres, avec un projet très en amont. Quand je m’y mets, c’est que j’ai été choisir dans mes petites boîtes une idée déjà présente, sauf pour Céleste Ma Planète, la seule exception qui était une commande de Je Bouquine. J’ai fait ce qui ne m’arrive jamais, j’ai cherché une histoire, alors que normalement les histoires m’habitent depuis très longtemps quand je commence à les raconter. Le livre de Perle est un modèle réduit de l’histoire d’un livre, ou, pour être grandiloquent, d’une œuvre, soit une histoire de ma vie, de mon écriture.
MM : Dans Le Livre de Perle, Colette Broutin, membre de nos comités de lecture, a relevé l’allusion à René Char, et notamment un de ses vers puisque Joshua saisit les mots « chagrin » et « cristal »(4). Pourquoi avoir choisi de l’intégrer
TF : Je voulais que le déclic de faire confiance à la vérité de l’imaginaire, en tentant de transformer le monde plutôt qu’en le fuyant, soit apporté par la poésie. Ce changement a été initié chez moi par la poésie, pas celle de René Char que j’ai découverte plus tard, mais celle des grands poètes français, ou deWhitman avec des textes très charnels autour de la nature. Le lecteur a l’impression que cette mission est donnée par un supérieur hiérarchique au moment où Joshua/Illian fait partie de la résistance, mais j’ai choisi de faire de Char mon personnage car je suis fasciné par cette double vie qu’il menait. Peu d’auteurs ont eu cet engagement physique dans la résistance. C’est particulier, dans le cas d’un poète, de se balader armé et de faire sauter des ponts. J’ai brouillé les pistes ensuite, même si tout ce qui est dit à son propos est vrai : le capitaine Alexandre était le nom de René Char pendant la guerre ; la peinture de de La Tour était devant son bureau, à l’endroit où il dirigeait les opérations. J’ai pioché dans Les Feuillets d’Hypnos(5), qui est presque un journal de guerre poétique, des extraits qui m’ont beaucoup frappé en particulier sur la violence, la cruauté et même la vengeance. J’ai supprimé des passages de ces pages, ce qui est très rare. Je m’étais laissé emporter par cette période qui me fascine. Olia apparaissait dans son quotidien, elle sauvait même secrètement la vie d’Ilian. Ce qui comptait c’était que ce soit le poète qui fasse changer le regard.
SLG : Olia, que vous venez de citer, est un personnage intéressant que l’on voit très peu alors qu’il tient le roman . Avec « le renoncement des fées », Olia rappelle La Petite Sirène même si vous rétablissez une happy end. Votre texte fait également écho à Orphée et Eurydice et j’y ai retrouvé un peu de Prouhèze et Rodrigue(6) avec leur impossibilité de se croiser.
TF : Cela correspond effectivement à ma petite symphonie intérieure. Il y avait certainement ces échos. Et puis, de toute façon, les amours impossibles existent en nombre !
SLG : Il y en a beaucoup, mais ceux-là, particulièrement, portent la notion de sacrifice, comme celui d’Olia qui renonce à sa vie. Comment expliquez-vous l’importance du sacrifice dans le couple que vous mettez en scène ?
TF : C’est vrai que cet aspect est bien plus présent que dans mes autres histoires d’amour, dans les précédents livres. On pouvait y trouver des prises de risques énormes pour l’autre, et puis des chassés-croisés comme entre Vango et Ethel. Mais dans Le Livre de Perle, c’est en effet poussé beaucoup plus loin parce qu’il y a une dimension mythique − je me suis autorisé à décréter des règles par une sorte de Deus ex machina. Je pense autant à Orphée qu’à Ondine(7), qui m’a beaucoup marqué. Je ne me l’étais pas formulé auparavant, mais je pense qu’il y a de l’Ondine dans Olia. Je me souviens de ma première lecture d’Ondine de Giraudoux et de la rencontre avec le chevalier et cette fille-poisson toujours dans l’eau impossible à attraper. On retrouve son rapport à l’eau, évidemment, et puis le grand sacrifice d’amour fou, une sorte de filtre d’amour qui renvoie à Tristan et Iseult, aussi. D’une manière générale, je suis beaucoup plus intéressé par les liens indéfectibles entre les personnages que par les amants dans les placards. D’un point de vue dramatique, Tobie Lolness repose entièrement sur la première rencontre au bord du lac entre Tobie et Elisha. C’est elle qui scelle le reste, sinon cela ne tient plus.

SLG : Je suis très frappée par le choix des prénoms et des noms dans l’ensemble de vos livres, jusqu’à Olia et Ilian avec leur petit signe qui se donne comme une porte graphique, visible, vers l’imaginaire. On sent votre jouissance à nommer vos personnages. Chaque nom semble détenir une histoire en lui-même.
TF : Oui, c’est exactement ça.
SLG : Comment les choisissez-vous ?
TF : Cela dépend des livres. Il y a parfois des certitudes – ce qui est bien agréable – qui deviennent même le nom de code du projet, des évidences comme Vango, Ethel. Elisha, je l’avais trouvé dans la descendance de Noé lorsque je travaillais sur la réécriture de la Bible.
SLG : Avec Elisha d’un côté, Tobie Lolness de l’autre, c’est le choc des rencontres improbables !
TF : Oui, dans Tobie, c’est particulièrement vrai. Je voulais brouiller les pistes. Il y a des noms à consonances nordiques, d’autres plus slaves, des noms franchouillards (Peloux), italiens (Tony Sireno), d’autres qui jouent les Western (Jo Mitch) ; je ne voulais pas que l’on situe cet arbre. Effectivement, le choix des noms est un moment très agréable. Pour mon prochain projet, je suis en train d’y réfléchir. Il s’agit de l’ héroïne, d‘une trilogie, donc je suis très content. Mais tant que je n’ai pas son nom, je n’ai pas le livre. Vango est un pêcheur crétois que j’ai rencontré en Grèce. Je trouvais qu’il y avait une énergie incroyable dans ce nom, Evangelisto. Lorsque je l’ai entendu résonner, je me suis dit que c’était sûr et certain qu’il deviendrait un jour celui de mon héros. Des années après, j’ai écrit une pièce de théâtre qui n’a pas vu le jour, et au moins quinze ans après, c’est devenu mon roman. Je voulais vraiment donner un destin à ce Vango. Pour Ilian et Olia, il fallait que je trouve un code, la marque d’une tradition. La graphie avec ce rond me semblait nordique. En fait elle provient des langues indiennes d’Amérique. J’avais utilisé un procédé voisin dans Céleste ma Planète avec le « i » mis à l’envers en point d’exclamation, qui devient ainsi une sorte de typographie, visuelle. Je reconnais que la typographie m’intéresse même si je ne m’en suis pas beaucoup servi pour le moment. Ces signes véhiculent aussi une étrangeté, très liée, pour moi, aux sagas Islandaises − à l’image que je m’en fais. C’est une façon de réinventer soi-même sa petite grammaire des racines et des préfixes. Avec Elisha qui est de l’hébreu, et Isha, j’avais joué les échos, puis j’avais caché dans Elisha le nom de son père. Je n’ai eu le prénom de Perle que plus tard. Pour lui, c’est très étonnant, très curieux, puisque ça fait des années, plus de quinze ans, que j’ai ce nom en tête, que je sais que la figure du collectionneur sera le point de départ du roman. Je dressais déjà des listes de sa collection, de ces débris du soulier de vair, il y a très longtemps, dans des carnets. Or, j’ai eu un choc cet été en découvrant qu’il y avait l’image de mon père dans ce personnage.
SLG : Et il y a « père » dans « Perle ».
TF : Tout à fait, tout à fait ! Et puis un trésor ! Il y aussi quelque chose des contes dans la perle, beaucoup en mentionne. Je n’y avais jamais pensé, mais il y avait la perle cachée dans l’huitre, cachée dans cette valise qu’est l’huitre, et qu’on trouve par hasard. J’aime les mots clefs, les univers poétiques.
MM : J’ai l’impression que Le Livre de Perle est un peu une symbiose de la part d’autofiction qu’on trouve en littérature générale et du côté plus expérimental de votre théâtre. Est-ce que c’était un moyen de faire le lien ?
TF : Oui, je suis d’accord. Je me retiens pour mes prochains projets de continuer dans une plongée trop analytique ou trop construite sur le mécanisme des histoires. J’ai envie de revenir à de la saga au premier degré, même si j’espère qu’il y en aura d’autres. Dès le début, j’ai su que ce projet contenait une dimension conceptuelle. Il y a effectivement une forme d’autofiction et une envie de clore un cycle autour de Tobie et Vango. Côté théâtre, c’est plus un besoin d’incarnation à travers le dispositif. Pour moi, le théâtre ne met pas du tout en scène des gens qui parlent, mais des liens entre des personnages. Dès le début, le spectateur les a sous les yeux et se questionne sur la façon dont ils vont s’en sortir. On retrouve cet aspect dans ce projet, qui prend un pas de recul par rapport à mes romans d’aventures. J’avais envie qu’il soit aussi un roman d’aventures mais parmi plein d’autres facettes. Pour chaque ouvrage − ce qui est souvent considéré comme un défaut − j’essaye de réunir les différents aspects d’une bande annonce d’Hollywood : « de la peur, de l’amour, de l’aventure, de la poésie… ». Comme je vis plusieurs années avec ces livres, le projet doit m’alimenter au quotidien.
SLG : Vos romans reposent sur une « hyper-structure » très marquée avec des parties, des chapitres… Les titres n’ont-ils pas la même importance que le nom de vos personnages ?
TF : De même qu’il y a un plaisir à nommer, il y en a un à titrer, avec des titres des chapitres qui peuvent surprendre, n’avoir aucun rapport avec ce qui précède ou qui s’éclairent seulement dans les dernières lignes du chapitre. C’est un contenu romanesque à part entière, une sorte de prime, de surplus de romanesque. Dans Tobie, Vango et Le Livre de Perle, il y a des titres, or, on me le fait très peu remarquer ; je crois pourtant que ça compte beaucoup.
SLG : Vous allez plus loin en donnant des titres aux parties également…
TF : C’est un plaisir ; j’aime bien le faire et j’ai rarement beaucoup d’hésitation. Parfois, c’est même un défi que je me lance : je mets un titre et j’y vais. Il m’arrive de revenir dessus après. Il y a des petits cas particuliers, Victoria Rêve, où j’ai décidé de prendre les derniers mots du chapitre pour le titrer: quelque chose se boucle ainsi à chaque fois. Ce sont des petits jeux de construction. Il est vrai que, même dans l’architecture du livre, cela compte beaucoup. C’est moins de la maniaquerie qu’une grande aide pour moi, d’avoir ces contours-là.
SLG : Ce besoin de structurer le texte vous vient-il du théâtre ?
TF : Tout à fait, il y a vraiment besoin de structure pour que cela tienne, d’actes, de scènes. Et cela s’applique au nombre de chapitres dans les parties. Je ne fais pas du tout mon malin là-dessus : il y a une part d’arbitraire que je me fixe qui n’est pas très noble, mais là par exemple, cela fait quand-même trois livres que je structure exactement de la même manière, les deux Vango et le Livre de Perle. J’ai 33 chapitres pour chacun, à chaque fois répartis en12/11/10. Je dois dire que j’ai une petite compétence qui m’aide, celle de savoir me mettre dans la tête du lecteur, y compris pour le frustrer !
… je préfère que le lecteur en ait plutôt un peu trop que pas assez.
MM : Lors de la master class du Labo des Histoires(8) vous disiez que votre règle d’écriture était de tout donner et de ne rien garder pour soi. Pourtant cette construction avec beaucoup de sauts temporels, ne met pas tous les éléments tout de suite dans les mains du lecteur…
TF : Quand je dis tout donner, c’est ne pas étaler une bonne idée sur plus de place, ou la garder pour un autre projet. De livre en livre, je réfléchis vraiment à la manière dont ils se répondent mais je ne fais pas de provisions d’idées, ce qui me parait la moindre des politesses. Je remarque la surprise que peut provoquer le fait qu’une petite histoire racontée dans Tobie, pourrait parfois devenir un livre. C’est encore plus vrai dans l’accélération sur la fin, par peur de lasser. Pour Vango, la troisième partie aurait vraiment pu être un volume supplémentaire et le dernier chapitre aussi. Ce sont des peurs et des angoisses personnelles, mais je préfère que le lecteur en ait plutôt un peu trop que pas assez. Je ne mets effectivement pas tout n’importe comment, je retiens une information et je la lâche assez prudemment au bon moment… ou au mauvais moment.
MM : Une partie sème tandis que l’autre récolte.
TF : C’est pour cette raison qu’il faut s’accrocher pendant la première partie, ce que j’ai particulièrement senti pour ce livre dans les retours, dans les discussions ou dans des articles. Je n’avais pourtant pas du tout le sentiment de faire une intrigue aussi puzzle. L’effet d’égarement est plus grand que prévu, même si j’aime bien ce grand écart à la fin. Je m’engage aussi vis-à-vis du lecteur, car je n’ai vraiment pas le droit de ne pas savoir où je vais. J’aimerais revenir à plus de linéarité, de chronologie, pour ne pas en faire une technique systématique. L’avantage c’est que je suis obligé d’avoir une très grande rigueur de construction, sinon la déception est immense. D’ailleurs, je n’en reviens pas qu’aucun retour négatif n’ait été fait sur la fin qui est quand même une pirouette, un choix très délicat. Je pense que c’est parce que le lecteur ressent mon émotion, partage ma séparation des personnages. Comme je prenais un risque, le public a été compréhensif, il a cherché à voir où je voulais en venir. J’ai été surpris, parce que normalement, les échos comprennent toujours quelques réserves, mais elles se sont plutôt exprimées à propos du début.
SLG : Vous travaillez vos incipits comme de la dentelle. Je vous ai régulièrement entendu citer le début de Tobie, en prêtant une grande attention au tempo. La première scène de Vango est très impressionnante. Le Livre de Perle commence par l’image extrêmement poétique de cette fille-fée qui court sur la plage. Vous avez expliqué la façon dont vous construisiez les romans, quelle est la place de l’incipit, ce tableau pictural très net ? S’impose-t-il à la fin ? Est-ce votre point de départ?
TF : Oui, c’est un tableau tout autant qu’une promesse. C’est aussi une couleur pour l’ensemble du livre. Mais cette partie reste un peu à part dans le roman. Même si c’est une promesse, je n’ai pas à m’astreindre à cette dentelle-là tout au long des pages. Effectivement, je ne me l’étais jamais formulé, mais je pense que le début du livre est un exercice ou un genre en soit. Il faut réussir à ne pas être trop caricatural dans ce souffle qu’on a envie de donner, mais en même temps, il ne faut pas avoir peur d’y aller carrément avec quarante hommes en blanc couchés devant Notre-Dame. Pour Le Livre de Perle, j’ai commencé par écrire le deuxième chapitre puis j’en ai ressenti le besoin. Comme j’ai écrit cet incipit après les six ou sept premiers chapitres, c’est presque un prologue pour moi, ce que normalement je ne fais pas. J’observe que je commence vraiment par le moment clef de l’histoire, le point de basculement.
Propos recueillis par Sonia de Leusse-Le Guillou, directrice de Lecture Jeunesse et de sa revue, et Marieke Mille, rédactrice en chef de Lecture Jeune, en janvier 2015.
1. La Bulle, Gallimard jeunesse, 2015.
2. Le livre de Perle, p. 1 : « Ses pieds ne s’enfonçaient pas mais élargissaient autour d’elle, à chaque bond, un cercle d’eau et de petits crabes ».
3. Dans Vango, un des personnages se nomme Zephiro.
4. La citation à laquelle l’auteur fait référence est la suivante : « C’est quand tu es ivre de chagrin, que tu n’as plus du chagrin que le cristal » (ndlr).
5. Gallimard, 1946.
6. Le Soulier de satin, Paul Claudel.
7. Jean Giraudoux, Grasset, 1939.
8. Voir le compte rendu sur le site du Labo des histoires (ndlr).

Timothée de Fombelle
Timothée de Fombelle est auteur et dramaturge. Il a également été professeur de lettres, dans une autre vie…
A 17 ans il monte une troupe de théâtre pour laquelle il écrit et met en scène. Sa pièce « Le phare », écrite l’année suivante, est traduite et jouée en Russie, Lituanie, Pologne et au Canada et reçoit le prix du Souffleur en 2002. Depuis, il n’a cessé d’écrire pour le théâtre. Son texte Je danse toujours (Actes Sud) a été lu à l’ouverture du festival d’Avignon, en 2002.
Tobie Lolness, son premier roman, paru en 2006, rencontre un succès mondial. Il est traduit en 28 langues, il reçoit une vingtaine de prix français (Le prix St Exupéry, Tam Tam, Sorcières…) et internationaux parmi lesquels le prix anglais Marsh Award, le prix italien Andersen. Les droits d’adaptation au cinéma ont été acquis par Amber Entertainment (Grande-Bretagne, États-Unis). Il reçoit de nombreux prix pour ses livres notamment en 2014 le prix pépites du salon du livre de Montreuil pour Le Livre de Perle.
(Source : Gallimard)